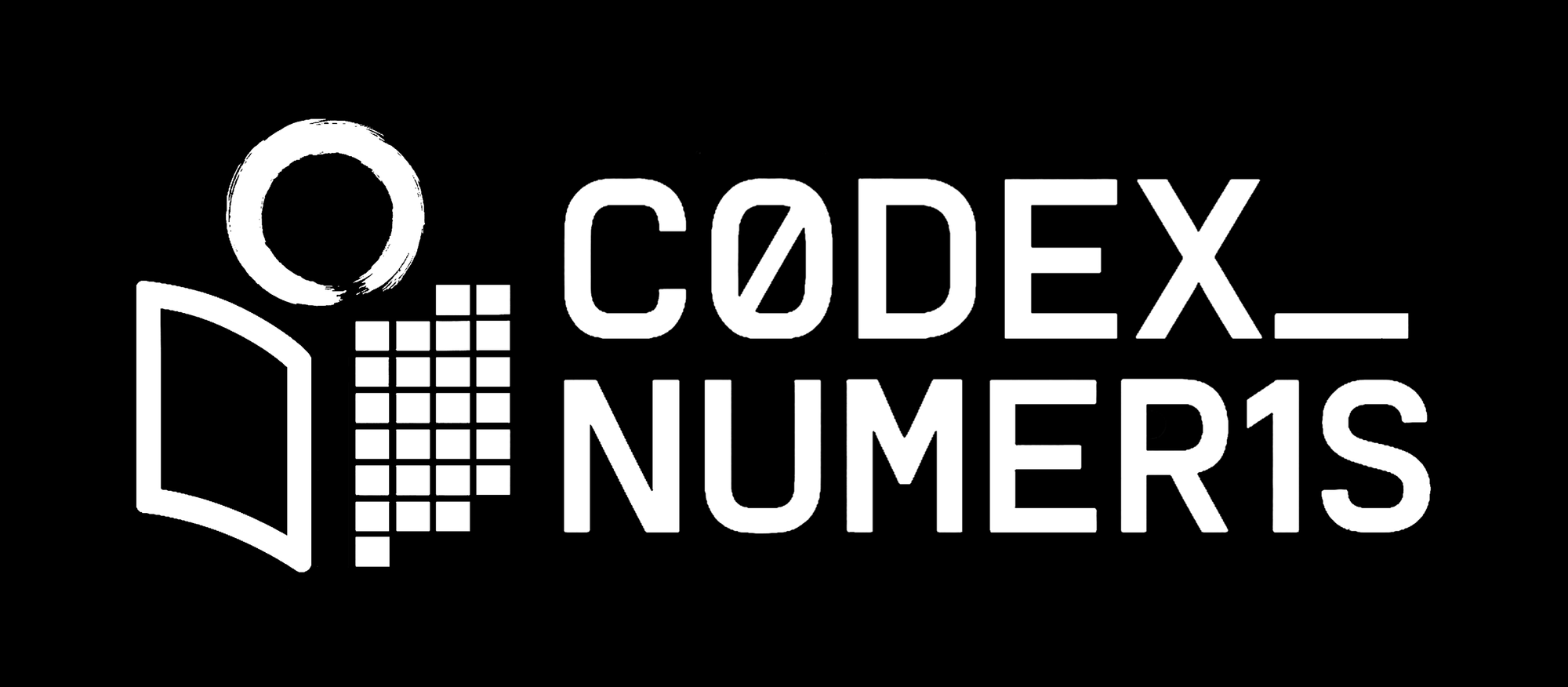27‣ Pratiquer l’enseignement explicite
Comment rendre visibles les processus cognitifs pour développer l'autonomie intellectuelle chez les élèves ? L'enseignement explicite offre un cadre structuré mais flexible pour accompagner chaque élève dans la construction de ses savoirs.

L'enseignement explicite s'appuie sur deux piliers fondamentaux : l'efficacité démontrée par la recherche et l'explicitation des processus cognitifs, de manière à mieux se les approprier. Voyons comment cette méthode transforme la relation enseignement-apprentissage en construisant progressivement l'autonomie intellectuelle des élèves.

Origines et fondements
► DÉVELOPPÉ initialement par Siegfried Engelmann sous le nom d'enseignement direct (Direct Instruction), cette approche a démontré son efficacité lors du projet Follow Through (1967-1977), une vaste étude comparant différentes méthodes pédagogiques. Dans les années 1980, Barak Rosenshine enrichit l’enseignement direct en le transformant en enseignement explicite. Il s’appuie sur de multiples principes pédagogiques pour formaliser la méthode à travers différentes modalités et procédures.
Entrons en classe et voyons comment se déroule concrètement ce type d’enseignement dirigé.
1) L’ouverture de la leçon, ses objectifs et les liens avec les connaissances antérieures
→ L’enseignant·e expose les objectifs de la séquence et rappelle les connaissances antérieures préalables.
- Au début d'une leçon sur l'analyse littéraire, j'ai annoncé l'objectif de la leçon : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à élaborer une carte mentale. Est-ce que quelqu'un se doute de ce que c'est et à quoi ça sert ? ». Des élèves ont proposé quelques hypothèses.
- Puis j'ai enchaîné avec une révision des étapes que nous avions suivies jusque-là pour analyser un chapitre de l’oeuvre au programme. «Qu'avons-nous fait en phase de pré-lecture ?». Nous avons rappelé l'importance d'étudier le paratexte « pour faire quelques prédictions» et éventuellement neutraliser nos biais de lecture. «Exact ! Qu’avons-nous fait ensuite ?»
- Un élève a ajouté que «nous avions fait la première lecture et observé nos réactions initiales face au texte». C'est un moment crucial pour observer nos réactions, nos questions, nos doutes, nos surprises et nos émotions face au texte. Ces observations sont précieuses pourquoi ? «Pour comprendre comment le texte crée des effets sur nous». Un aspect que nous approfondirons plus tard dans notre analyse. «Très bien ! Après?»
- Quelqu'un a rappelé que «nous avons appliqué des stratégies de lecture au texte». Elle a rappelé l'importance d'annoter le texte, parce que ces annotations servent à prolonger notre mémoire de travail qui est très limitée : «Ça dure max vingt secondes !». Nous identifions les mots importants, nous notons dans la marge pourquoi ils sont importants ou révélateurs, et nous identifions les procédés littéraires utilisés pour mettre en valeur ces idées. «Excellent...»
- «Maintenant à quoi sert la carte mentale, vous croyez ?» Les élèves font le lien : à organiser nos idées !
2) La modélisation (ou le modelage) : « Je fais. »
→ L’enseignant·e pose un « microphone sur sa pensée » et expose à voix haute le raisonnement qu’elle fait lorsqu’elle applique une stratégie.
- Nous approfondissons donc le concept de carte mentale. On y trouve trois composantes principales : «l'hypothèse d'objectif de communication», que l'on place au centre de notre feuille, les «mécanismes» utilisés par l'auteur, puis les «procédés» qui constituent ces mécanismes. «Qu'est-ce qu'on avait trouvé la dernière fois ?» Les élèves fouillent dans leurs notes.
- La modélisation me permet d'exposer aux élèves mon propre raisonnement avec un iPad projeté à l'écran. J'ai le même texte que les élèves sur leur feuille. Je trace un exemple, j'encercle, je souligne, j'efface, je reformule. Cet outil me permet non seulement d'écrire ce que j’observe en temps réel, mais aussi de montrer aux élèves comment je réfléchis, comment je doute, comment je me questionne, comment je cherche à bien nommer mes idées en pensant en voix haute. Ils peuvent ainsi voir concrètement le processus de pensée en action – live on stage – ce qui rend l'apprentissage tangible et plus accessible. Ils recopient tout sur leur feuille. Et je pose quelques questions pour les solliciter.
- Je souligne ici l'aspect dynamique du processus. La démonstration vise à encourager les élèves à voir la carte mentale comme un outil flexible, évolutif, : «il n'y a pas de mauvaises idées, seulement des idées qui se transforment». Je montre comment je ne suis pas toujours certain de mes choix et que je n’hésite pas à modifier ma carte au besoin. Quand je biffe une idée, quand je reformule une explication qui ne me satisfait pas, je montre aux élèves que l'apprentissage est un processus continu, fait d'essais et d'erreurs. Que l'écriture va de paire avec la réécriture. Cette transparence crée un environnement où l'erreur est vue non pas comme une faiblesse, mais comme un tremplin vers plus de profondeur.
3) La pratique guidée : « Nous faisons ensemble. »
→ Avec l’aide de l’enseignant·e, les apprenant·es appliquent la stratégie pas à pas.
- Pour moi, la pratique guidée se déroule en deux temps : un travail collectif où le groupe et moi élaborons ensemble un exemple, puis un travail individuel supervisé où je circule pour accompagner chaque élève. Cette étape permet d'ajuster le soutien selon les besoins.
- Prenons cette fois pour exemple l’enseignement du plan de rédaction parce qu'il me permet d’illustrer ces deux façons de guider la pratique. En premier lieu, nous faisons le plan d’un premier paragraphe en grand groupe. Nous formulons ensemble une hypothèse d'objectif de communication, nous identifions les mécanismes littéraires à l’oeuvre et nous sélectionnons des preuves pertinentes à travers des procédés littéraires. Pendant ce processus très dynamique, je pose beaucoup de questions (et je modélise ainsi la métacognition). Je fais parfois semblant que je ne suis pas toujours certain de mes choix. Puis je détaille la structure du plan, j’explique comment chaque idée principale correspond à un mécanisme, et chaque idée secondaire aux constituants de ce mécanisme, incluant les procédés littéraires.
- Ensuite, les élèves se penchent individuellement sur le deuxième paragraphe et cette fois je circule entre les bureaux. Je réponds aux questions, je vais voir ceux que je dois superviser plus étroitement. Je continue de poser beaucoup de questions. Ici, je souligne la différence entre les idées principales, formulées en phrases complètes avec un sujet et un prédicat. Là, j’aide à développer les idées secondaires, présentées de manière plus schématique avec des mots-clés et des flèches. Mes interventions servent à structurer la pensée, à partager des trucs pour identifier les idées, à les nommer précisément. C’est une forme de modélisation de la pensée à travers une foule de questions. J'essaie consciemment de modéliser ma propre métacognition et ma propre autorégulation.
- Je donne beaucoup de rétroaction à cette étape. Cette forme de pratique guidée me permet d’accompagner individuellement chaque élève et de bâtir progressivement une relation pédagogique sécuritaire et bienveillante. J'aime beaucoup cette étape.
4) La pratique autonome : « Vous faites. »
→ Sans l’aide de l’enseignant·e, les étudiants et étudiantes s’approprient la façon de faire de façon autonome.
- Lors de la pratique autonome, mes interventions sont moins nombreuses, car l’étayage diminue progressivement. Je donne un peu moins de conseils explicites : je réponds aux questions par... d’autres questions. La pratique autonome est parfois une simulation formative, parfois une évaluation plus formelle des compétences. Dans ce cas, la rétroaction est différée et donnée par écrit plutôt qu’oralement en temps réel. Je laisse l’élève expérimenter de manière autonome, je le laisse s’autoréguler tout en observant son comportement.
- À cette étape, les apprenant·es font donc leur carte mentale ou leur plan tout seuls. Ils appliquent en solo les stratégies de lecture, de rédaction ou de révision que nous avons d'abord modélisées, puis pratiquées en groupe.
5) La clôture de la leçon : la consolidation ou l'objectivation des apprentissages
→ L’enseignant·e voit à l’objectivation de l’apprentissage avec les apprenant·es afin de le formaliser dans la mémoire à long terme.
- L'objectivation, désormais systématique, clôt chaque séance. Par des questions ciblées, les élèves sont amenés à expliciter leurs apprentissages : les procédures que nous avons appliquées, la carte mentale que nous avons tracée, le plan que nous avons organisé. Ce retour sur les objectifs initiaux reste primordial pour consolider les acquis. Ce sont les élèves qui doivent expliciter à voix haute leur apprentissage.
L’enseignement explicite expose clairement et régulièrement les objectifs d’apprentissage et les aligne sur les critères de performance qui seront appliqués plus tard. Il repose sur un parcours progressif favorisant l’autonomie de l'élève : la modélisation lui montre la marche à suivre, la pratique guidée lui permet de l’appliquer sous supervision, puis la pratique autonome la conforte dans sa maîtrise. Le questionnement et la rétroaction fréquente jouent un rôle crucial dans cette pratique. Ils éclairent les zones d’ombre et les doutes, stimulent la réflexion et renforcent la mobilisation et l’engagement.
Parfois, un bloc de 2h peut être consacré à la modélisation et la première phase de la pratique guidée, sans que nous fassions la deuxième phase, plus individuelle, ou sans que nous ne fassions la pratique autonome qui sera réservée à un autre cours. Mais à la fin – à chaque fois, systématiquement – nous faisons l’objectivation de la leçon et j’interroge les élèves sur ce qu’ils ont appris. Je boucle le cours avec les objectifs annoncés au début de la leçon.
L’expertise vient avec la pratique
L'enseignement explicite représente selon moi bien plus qu'une simple méthode pédagogique – c'est une transformation profonde de la relation avec les apprenant·es. En rendant visibles les processus cognitifs, il permet aux élèves de développer une véritable autonomie intellectuelle. Cette approche prend un sens particulier aujourd’hui, où la capacité à comprendre et à maîtriser ses propres processus d'apprentissage est très importante.
Au fil des ans, j'ai constaté que la maîtrise progressive de l'enseignement explicite m'a permis de ralentir mon rythme d'enseignement – non par inefficacité, mais pour créer plus d'espace pour l'interaction, l'ajustement, l'observation. Cette lenteur pédagogique s'avère paradoxalement plus efficace. Elle permet un meilleur ancrage, une construction plus durable des savoirs et des compétences. J’y reviendrai dans une prochaine chronique où nous aborderons l’approche «Slow professor» et l’autorégulation.
Je crois que dans un monde où l'intelligence artificielle peut instantanément générer du contenu, la valeur ajoutée de l'enseignement réside plus que jamais dans la relation entre l'enseignant·e et l'apprenant·e, dans la possibilité de guider le processus de la pensée critique et le développement de l'autonomie intellectuelle. L'enseignement explicite offre un cadre structuré mais flexible pour accompagner chaque élève dans la construction de ses savoirs. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 13 janvier 2025 · Révisé le 23 août 2025
Références
Gauthier, C., & Tardif, M. (2017). La pédagogie (4e édition) : Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours. Gaëtan Morin.
C. Gauthier & S. Bissonnette (2023), Enseignement explicite et données probantes. Gaëtan Morin Éditeur.
Gauthier, C., Bissonnette, S., & Richard, M. (2013). Enseignement explicite et réussite des élèves : La gestion des apprentissages. Gaëtan Morin Éditeur.
Hollingsworth, J., & Ybarra, S. (2012). L'enseignement explicite. Chenelière.
Marzano, R. J. (2017). New Art and Science of Teaching: More Than Fifty New Instructional Strategies for Academic Success, Solution Tree Press.
À explorer
Pour découvrir l'application concrète des stratégies :
- 17‣ Enseigner des stratégies - Cette chronique détaille l'enseignement explicite des stratégies cognitives spécifiques (lecture, carte mentale, révision linguistique), illustrant concrètement comment la progression modelage → pratique guidée → autonomie se traduit dans l'acquisition d'outils méthodologiques précis.
Pour comprendre l'aboutissement vers l'autonomie :
- 20‣ Exploiter le portfolio (3/3) - métacognition et autonomie - Cette chronique explore comment l'enseignement explicite des processus cognitifs se transforme en métacognition authentique et en autorégulation, montrant l'évolution de l'élève guidé vers l'apprenant autonome à travers des données concrètes de progression.
Pour saisir l'impact social de cette approche :
- 30‣ Agir sur les inégalités scolaires - Cette chronique révèle comment l'enseignement explicite constitue une "pédagogie rationnelle" qui démocratise l'accès aux apprentissages en rendant visibles les processus implicites, offrant ainsi un levier concret contre la reproduction des inégalités scolaires.
Pour intégrer cette méthode dans un cadre systémique :
- 34‣ Appliquer le modèle de la Réponse à l'intervention (niveau 1) - Cette chronique situe l'enseignement explicite comme première stratégie d'un enseignement universel de qualité, démontrant comment cette approche s'inscrit dans un modèle global d'intervention qui vise la réussite de 80-90% des élèves.