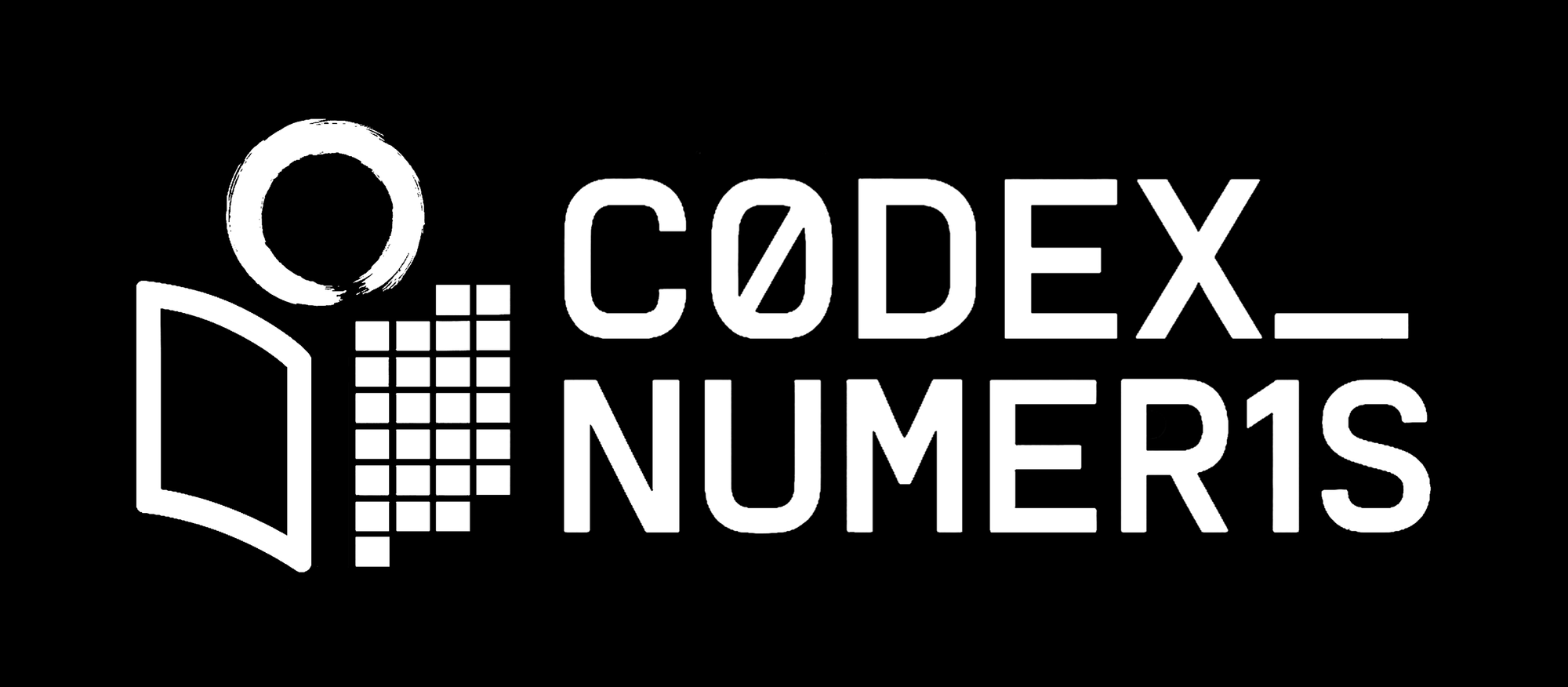20‣ Exploiter le portfolio (3/3) : métacognition et autonomie
Comment le portfolio développe-t-il la métacognition et l'autonomie ? Trois moments réflexifs et l'usage stratégique des jetons révèlent leur importance.
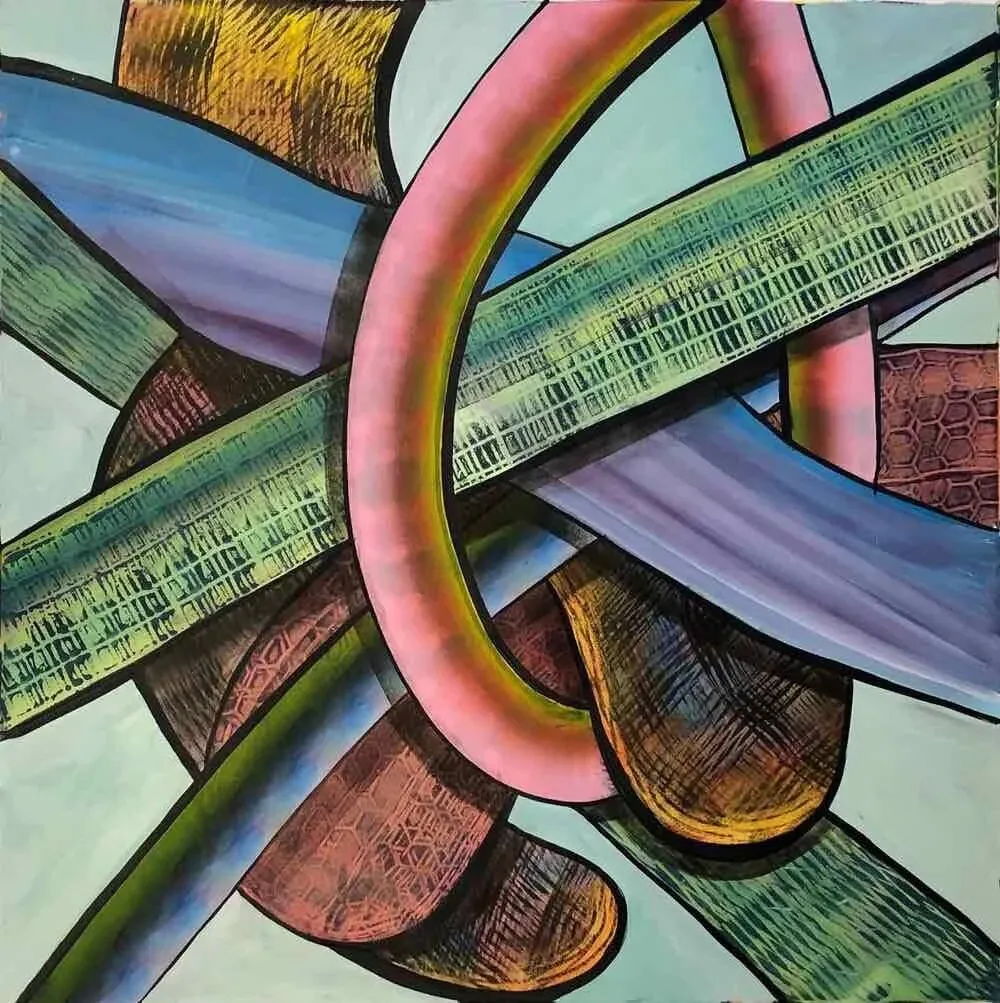
Dans ce troisième et dernier volet de la série sur le portfolio, nous allons observer comment se fait le développement de la métacognition et de l'autonomie chez l'apprenant·e. D'une part, l'organisation du portfolio établit trois moments réflexifs clés qui rendent visible le processus d'apprentissage. D'autre part, l'analyse des jetons de reprise révèle leur usage stratégique, une amélioration immédiate et, surtout, le maintien durable de cette progression.

Une architecture qui rend l'apprentissage visible
► LE portfolio ne se contente pas de collecter 14 travaux durant le trimestre (automne 2024) : il est construit pour rendre visible le processus d'apprentissage lui-même, autant pour l'enseignant·e qui évalue et modifie son approche en fonction des besoins, que pour l'apprenant·e qui ajuste ses stratégies et son engagement. Cette autorégulation de l'enseignant·e et de l'apprenant·e est rendue possible grâce à trois moments clés de réflexion.
Le «Portrait de lecteur» initial, premier artefact du portfolio, invite l'élève à examiner son rapport à la lecture et à l'analyse. Plus qu'un simple exercice d'introspection, ce texte d'environ 500 mots pose les bases d'une conscience réflexive que les artefacts suivants viendront enrichir.
Les deux artefacts métacognitifs (n°3 et n°11), stratégiquement placés dans le parcours, offrent des moments privilégiés de réflexion sur l'apprentissage. L'analyse des données par l'IA montre une évolution intéressante entre ces deux moments. La structure des résultats de l'apprentissage observé permet de comprendre le changement qui s'opère. Prenons l'exemple d'un élève dont le premier artefact métacognitif obtient une note de M (maîtrisé), démontrant une bonne capacité réflexive initiale centrée sur les aspects techniques («structure» et «rigueur»). Dans l'artefact n°11, sa performance atteint encore le niveau M, mais avec une amélioration notable dans la «nuance» et la «plausibilité» de sa réflexion. Cette transformation révèle une compréhension plus complexe de ses processus d'apprentissage.
Cette évolution métacognitive constitue le fondement sur lequel peut se construire une pensée complexe et une véritable autonomie d'apprentissage, second pilier de la transformation visée par le portfolio.
Utilisation des jetons pour réguler son propre apprentissage
L'analyse des données recueillies à l'automne 2024 révèle aussi des patterns intéressants concernant l'utilisation des jetons de reprise et leur impact sur l'apprentissage. Parmi les élèves suivis (n = 53), un peu plus de 40% ont utilisé au moins un jeton durant le trimestre, la majorité optant pour une seule utilisation. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est le moment choisi pour ces reprises : elles se concentrent majoritairement dans la seconde moitié du trimestre. Je pense que ceci suggère une utilisation bien plus réfléchie qu'on pourrait le croire.
En effet, l'impact de ces jetons sur la progression des élèves est significatif. Parmi ceux qui ont utilisé un jeton, l'intelligence artificielle nous révèle que trois élèves sur quatre montrent une amélioration immédiate d'un niveau dans l'échelle IDME dès l'artefact suivant. Plus important encore, cette amélioration n'est pas ponctuelle : près des deux tiers maintiennent cette progression sur les artefacts subséquents. Les élèves qui ont choisi d'utiliser leurs deux jetons montrent une progression encore plus marquée, avec un écart de deux niveaux SOLO par rapport à leur performance initiale dans plus de 80% des cas !
La comparaison avec les élèves qui n'ont pas utilisé leurs jetons est éclairante. Bien que ces derniers progressent également, leur parcours est marqué par plus d'irrégularités et de périodes de stagnation. Cette observation suggère que les jetons, lorsqu'ils sont utilisés stratégiquement, agissent comme des leviers d'apprentissage en permettant de débloquer des situations de plateau.
Je trouve qu'un aspect particulièrement intéressant émerge de l'analyse : les données montrent une corrélation significative (0,72) entre l'utilisation stratégique des jetons et la progression des apprentissages. Cette corrélation est encore plus forte lorsque l'utilisation des jetons s'accompagne d'une assiduité régulière (indice A), soulignant l'importance de l'engagement continu dans le processus d'apprentissage.
Bien sûr, ces résultats, bien qu'encourageants, doivent être interprétés avec prudence. La taille modeste de notre échantillon (53 élèves) et la multiplicité des facteurs en jeu (parfois externes) ne permettent pas d'établir une relation causale absolue. Cependant, les tendances observées laissent penser que les jetons, intégrés dans une approche globale de suivi et d'accompagnement, constituent un outil efficace pour soutenir la progression des apprentissages. Je n'en demande pas plus pour poursuivre mon expérimentation !
Ces données analysées par l'IA soulignent l'importance d'accompagner le système de jetons d'une réflexion sur leur utilisation stratégique. Il ne suffit pas de les mettre à disposition, il faut guider les élèves dans leur utilisation, en les aidant à identifier les moments où une reprise pourra véritablement servir leur progression. Comme il s’agissait pour moi d’une première expérimentation cet automne, j’ai permis à certains élèves l’utilisation exceptionnelle d’un 3e ou même d’un 4e jeton. Ils m’avaient demandé conseil en début de session et je n’étais pas tout à fait en mesure de donner un avis éclairé. Pour ne pas les pénaliser, j’ai opté pour… une reprise moi aussi ! Ici, tout le monde apprend.
Les défis de la métacognition
L'analyse des portfolios par l'intelligence artificielle nous révèle une progression métacognitive qui se déploie en trois phases distinctes et complémentaires. Dans un premier temps, l'apprenant·e traverse une phase d'observation et prend conscience de ses processus d'apprentissage, notamment en documentant systématiquement les stratégies qu'il utilise et leurs résultats. Cette première étape ouvre la voie à une phase d'analyse plus approfondie, durant laquelle l'apprenant·e commence à établir des liens significatifs entre ses actions et ses performances. Cette réflexion lui permet de développer une compréhension plus fine et nuancée de ce qui fonctionne ou non dans sa démarche d'apprentissage. Enfin, fort de ces observations et analyses, l'apprenant·e atteint une phase d'autorégulation où il devient capable d'ajuster consciemment ses stratégies en fonction de ses expériences précédentes. Cette dernière phase témoigne d'une véritable prise en charge de son apprentissage. Elle marque l'aboutissement d'un processus qui transforme l'élève en apprenant autonome.
Bien sûr, le développement de cette conscience métacognitive n'est pas sans obstacles. J'ai en tête le cas d'un étudiant dont les performances aux artefacts métacognitifs (D puis 0) déclinent. Ceci illustre comment les difficultés dans la métacognition peuvent refléter et amplifier des difficultés plus générales d'apprentissage. Ce cas rappelle l'importance d'un accompagnement différencié. Il requiert une intervention de niveau 3 que je ne suis pas en mesure de faire tout seul.
Les observations globales de mon projet pilote à l'automne 2024 montrent que les apprenant·e qui maîtrisent les stratégies métacognitives obtiennent des résultats significativement meilleurs en «plausibilité» (+24,8%) et en «nuance» (+32,3%). Ces apprenant·es développent une pensée plus complexe, un esprit critique plus fort.
L’autonomie
L'autonomie n'est pas quelque chose qui se décrète : c'est quelque chose qui se construit lentement, progressivement, à travers l'acquisition de stratégies efficaces que l'on consolide. Le portfolio guide cette construction à travers plusieurs mécanismes complémentaires.
Le développement de l'autonomie est rendu visible dans les informations du tableau de bord de monitorage. Les corrélations entre les performances aux artefacts métacognitifs et la progression générale sont particulièrement révélatrices : les élèves qui excellent dans ces moments de réflexion (notes égales ou supérieures à M) montrent une progression plus stable dans leurs autres travaux.
La forte corrélation entre la maîtrise des stratégies de base et le développement des compétences analytiques plus complexes suggère également que cette approche métacognitive porte ses fruits.
Les stratégies de lecture, documentées dans les artefacts n°5 et n°14, constituent un premier pilier de cette autonomie. Les données analysées par l'IA montrent une progression significative dans le parcours d'un·e apprenant·e qui passe d'une note M à E (étendu ou enrichi). Cette maîtrise des stratégies se reflète directement dans sa capacité à aborder des textes de plus en plus complexes.
L'autonomie croissante des apprenant·es se manifeste aussi à travers plusieurs indicateurs observables en classe et dans leur portfolio :
- L'utilisation stratégique de leurs jetons de reprise démontre une capacité à faire des choix réfléchis pour les suites de leur apprentissage. L’utilisation d’un jeton est particulièrement stratégique quand elle prépare à une évaluation ultérieure.
- L'initiative dans le choix et l'adaptation des stratégies de lecture et d'analyse montre une compétence et une autonomie en développement. La complémentarité des stratégies est un élément qui permet de développer la nuance de la pensée.
- En classe, j'observe que la pertinence grandissante de leurs questions, après avoir reçu une rétroaction, révèle une compréhension plus fine des attentes à leur égard.
De la réflexion à l'action
Mais je crois que le véritable succès de cette approche «portfolio» réside dans sa capacité à transformer la réflexion métacognitive en action concrète. Les apprenant·es ne se contentent pas de réfléchir à leur apprentissage : ils développent leur capacité à ajuster leurs stratégies, à identifier leurs besoins et à prendre en charge leur progression. C'est pas rien, ça, les amis !
Cette approche s'aligne parfaitement avec les quatre axes de développement visés par la discipline Français au collégial (Bélec et Doré, 2023, p. 1) : le «développement du regard de l'individu sur lui-même» et de sa capacité à prendre une distance critique indépendante, le «développement de son intelligence émotionnelle» et de ses compétences relationnelles, le «développement de sa posture intellectuelle» et le «développement de ses compétences créatives».
La résilience développée à travers ce processus – la capacité à apprendre de ses erreurs et à rebondir après les difficultés – constitue peut-être l'acquis le plus précieux. Ces apprentissages, bien qu'invisibles dans une note centrée sur la performance, représentent des compétences durables et transférables qui serviront l'élève tout au long de sa formation. Les données recueillies montrent que les élèves qui réussissent le cours ont développé ces acquis fondamentaux, posant ainsi une base solide pour la suite de leur parcours.
Une transformation pédagogique
Au terme de cette deuxième exploration du portfolio comme outil de transformation pédagogique, quelques constats s'imposent. D'abord, je crois que la réussite de cette approche repose sur un alignement pédagogique soigneusement pensé qui allie rigueur méthodologique et flexibilité dans l'accompagnement. Ensuite, son efficacité dépend de facteurs clés comme l'engagement régulier et un système de rétroaction constructif. Enfin, et c'est peut-être là sa plus grande force, le portfolio catalyse une véritable transformation de l'apprentissage en développant la métacognition et l'autonomie des élèves.
Je pense que mon expérimentation démontre qu'il est possible de dépasser le paradigme traditionnel de l'évaluation normative pour créer un environnement d'apprentissage plus riche et plus formateur. Je crois que cette approche pourrait enrichir significativement nos pratiques pédagogiques, particulièrement dans un contexte où l'autonomie d'apprentissage devient une compétence de plus en plus importante.
Pour ce faire, il faut cependant accepter de remettre en question et de pratiquer autrement des compétences que l’on a développées depuis parfois plusieurs années. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H⇄IA:Ce
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 9 décembre 2024 · Révisé le 19 août 2025
Référence
Bélec, C. et Doré, R. (2023). Une recherche collaborative pour renouveler l'enseignement de la littérature au collégial dans une optique de cohérence disciplinaire : l'intérêt d'une approche par compétence de la lecture. [Rapport de recherche PAREA]. Cégep Gérald-Godin et Cégep de Drummondville. [En ligne]
À explorer
Pour comprendre les fondements du dispositif :
- 18‣ Exploiter le portfolio (1/3) - structure et contenu - L'architecture des 14 artefacts qui structure les trois moments réflexifs clés : portrait initial, artefacts métacognitifs n°3 et n°11 qui rendent visible le processus d'apprentissage
Pour identifier les conditions de réussite :
- 19‣ Exploiter le portfolio (2/3) - facteurs de réussite - Les quatre facteurs qui déterminent le développement métacognitif : engagement régulier, stratégies systématiques, cognition profonde et métacognition elle-même
Pour voir le système d'évaluation qui rend possible l'autonomie :
- 5‣ Mettre en place une pratique alternative de notation (PAN) - Le système de jetons de reprise et l'évaluation qualitative qui transforment l'erreur en opportunité d'apprentissage et favorisent l'utilisation stratégique des reprises
Pour comprendre la vision systémique de cette transformation :
- 40‣ Concevoir la classe comme un écosystème d'intelligence - Les boucles de rétroaction qui amplifient l'autonomie : engagement → performance → motivation, et comment la résilience développée constitue l'acquis le plus précieux et transférable