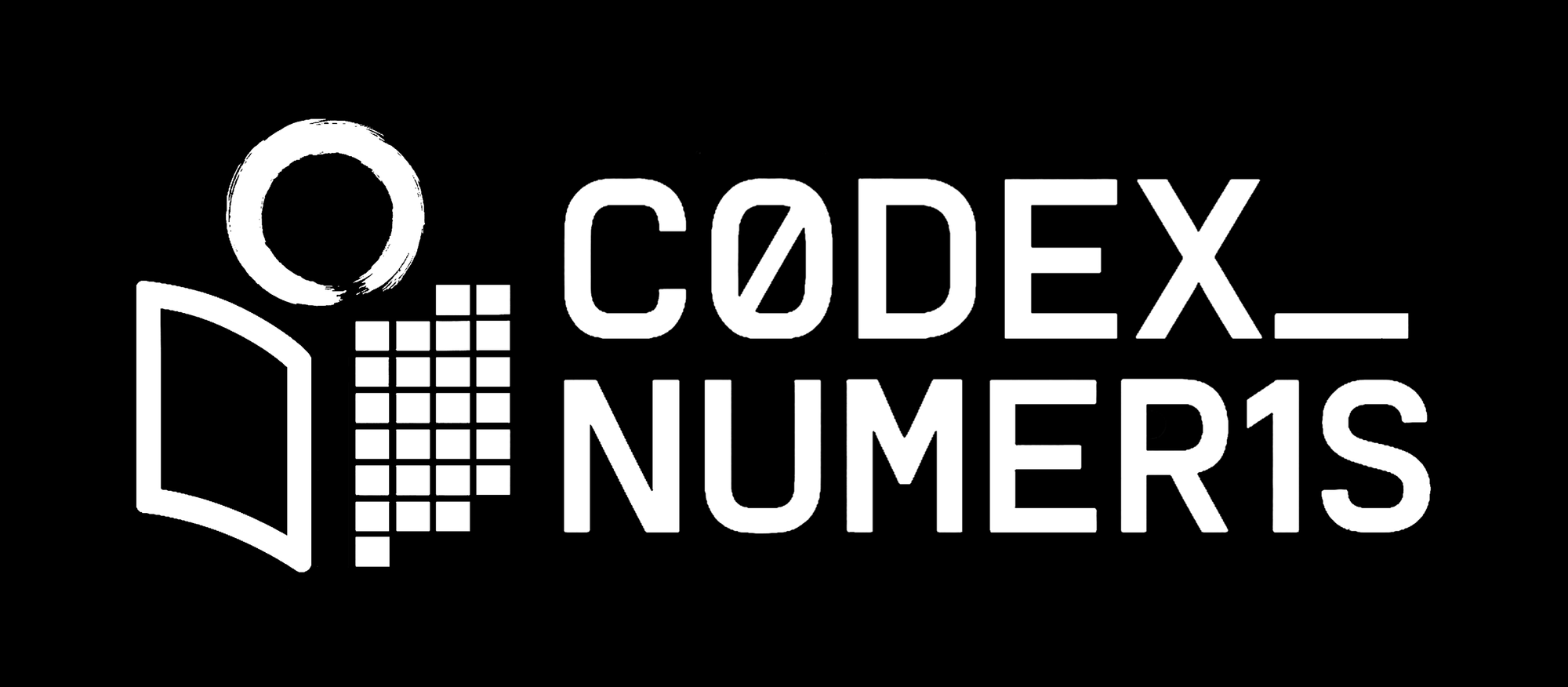19‣ Exploiter le portfolio (2/3) : facteurs de réussite
Comment l'engagement régulier, les stratégies systématiques, la cognition profonde et la métacognition déterminent-ils la réussite du portfolio ? Ces facteurs se renforcent mutuellement pour créer un environnement d'apprentissage optimal.
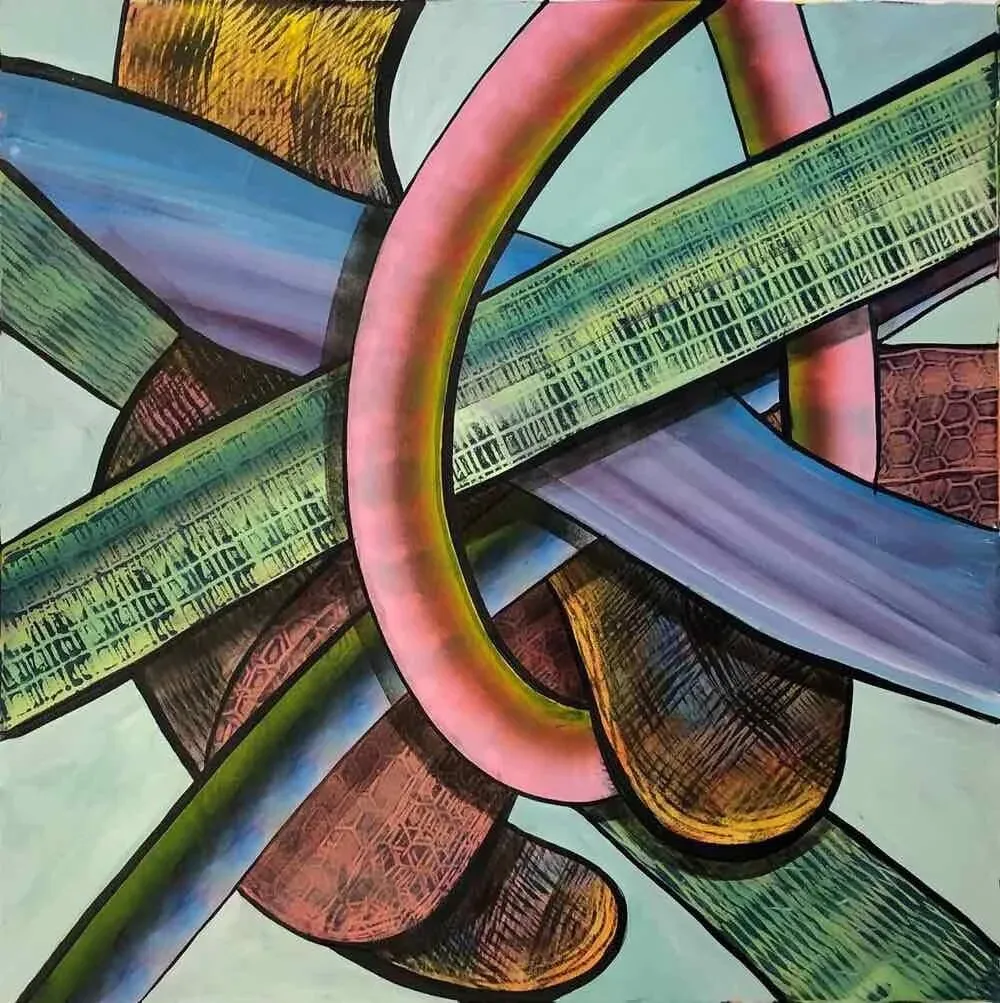
Dans ce deuxième volet de l'analyse des impacts du portfolio, nous nous penchons sur quatre facteurs de réussite : l'engagement régulier, l'application systématique des stratégies, la profondeur cognitive et le développement métacognitif. Ces facteurs se renforcent mutuellement pour créer un environnement d'apprentissage optimal. De plus, les observations révèlent une consolidation de la résilience de l'apprenant·e.

► AU-DELÀ DE la note finale qui sanctionne l'atteinte de la compétence, les acquis du portfolio dépassent largement les apprentissages visés par le cours Écriture et littérature. Cette approche permet le développement d'habiletés essentielles qui préparent l'élève pour la suite de son parcours. L'application du portfolio ici s'inscrit dans une vision plus large de la réussite éducative qui, comme le souligne le CREPAS (cité dans Bélec et Doré, 2023, p. 6), «concerne à la fois l'instruction (intégration de savoirs scolaires), la socialisation (acquisition de savoirs, valeurs, attitudes et comportements utiles au fonctionnement en société), la qualification (préparation à l'insertion professionnelle)» ainsi que «la réalisation de son plein potentiel et l'atteinte de buts personnels fixés par l'étudiant».
Facteurs de réussite
L'analyse par l'IA des données recueillies à l'automne 2024 révèle quatre facteurs importants pour le développement de l'apprenant·e à travers le portfolio. Les observations permettent de dégager leur importance relative et leurs interactions : ces facteurs, ne sont pas indépendants, ils se renforcent mutuellement.
1) L'engagement régulier comme base
L'engagement régulier et soutenu apparaît comme le premier pilier de la réussite. Les données montrent une corrélation significative (0.827) entre la complétion régulière des artefacts et la performance. Les élèves qui maintiennent un rythme de travail constant, visible dans la régularité des remises et la qualité des productions, développent une maîtrise plus solide des méthodes d'analyse. Cette régularité permet une appropriation graduelle des apprentissages, créant un cercle vertueux entre effort et progrès.
2) L'application systématique des stratégies
L'application systématique des méthodes de travail (lecture, rédaction, révision, métacognition) constitue un deuxième facteur clé. Les étudiants qui réussissent démontrent une utilisation cohérente et croissante des connaissances procédurales pratiquées en classe. Ceci est notamment visible dans l'amélioration constante de leur «structure» et de leur «rigueur», qui sont deux critères essentiels de la littératie.
3) La profondeur de l'engagement cognitif
L'engagement cognitif profond représente un autre facteur majeur, distinguant clairement les cas de progression des cas de régression. Les étudiants qui progressent démontrent une capacité croissante à établir des liens complexes et fins. Ceci est visible dans l'amélioration de la «plausibilité» des explications et de la «nuance» de leur interprétation, qui sont deux autres critères liés à la littératie.
4) Le développement métacognitif
La métacognition, manifestée par une conscience claire de leurs propres processus d'apprentissage, caractérise également les étudiants qui réussissent. Cette conscience se traduit par une utilisation efficace des rétroactions et une amélioration constante des aspects identifiés comme problématiques (par exemple l'utilisation des preuves, l'interprétation des procédés littéraires ou le travail sur certaines difficultés linguistiques ciblées par l'enseignant).
À travers ces facteurs, on peut identifier des vecteurs de stabilité : l'assiduité élevée, la complétion régulière des travaux et l'engagement constant. Les motifs de stabilité sont d'ordre méthodologique (structure constante, rigueur maintenue, progression graduelle) et linguistique (ratio d'erreurs stable, amélioration progressive, maintien des acquis).
Les causes d'instabilité quant à elles sont, sans surprise, d'ordre organisationnel (variations d'assiduité, remises irrégulières, engagement fluctuant) et cognitif (compréhension fragmentée, application inconsistante, difficultés méthodologiques persistantes). Ces caractéristiques sont visibles dès les premières semaines du trimestre et justifient une intervention précoce de l’enseignant·e.
Le sentiment de compétence
Si ces éléments constituent les fondations de l'apprentissage, nous voyons également que c'est le système de rétroaction qui en est le moteur principal. En créant une boucle récursive dans l'apprentisasge, le portfolio transforme chaque production en opportunité de progression. Chaque artefact reçoit des commentaires spécifiques qui valorisent les réussites et proposent des pistes d'amélioration concrètes. Cette approche différenciée permet aux élèves de comprendre précisément où ils en sont et comment progresser.
L'impact de ces rétroactions est mesurable : 79,5% des élèves indiquent qu'elles ont permis leur amélioration. Cette approche transforme le portfolio en véritable outil de développement. Comme le souligne Viau, «en lui disant seulement ce qu'il a fait de mal et en ne lui montrant pas ce qu'il a fait de bien, on l'incite à sous-estimer les apprentissages qu'il a réalisés et à avoir le sentiment qu'il n'y arrivera jamais.» (Viau, p. 156-157) Au-delà de la simple mesure de performance, le portfolio permet un développement durable des compétences tout en renforçant l'autonomie et le sentiment de compétence des élèves.
Le système de jetons de reprise renforce cette dynamique en offrant des occasions de révision stratégique. Les données montrent que les élèves qui utilisent judicieusement ces opportunités connaissent souvent une progression plus marquée.
Le développement de la résilience
Le développement des compétences en analyse littéraire se révèle comme une véritable métamorphose qui transforme progressivement et simultanément plusieurs dimensions de la pensée et de l'expression des étudiants.
D'abord, sur le plan de la méthode de travail, on peut voir une amélioration notable de la capacité à structurer l'analyse, comme en témoigne la progression des notes en «structure» qui passent en moyenne de D à M. Cette progression s'accompagne, sur le plan linguistique, d'une légère amélioration dans la précision et la richesse de l'expression, visible dans l'évolution du critère «français». Parallèlement, sur le plan analytique, les données révèlent un développement significatif de la complexité des observations et des interprétations, comme le démontre l'amélioration des scores en «plausibilité» et en «nuance». Cette transformation simultanée des différentes dimensions de la compétence, bien que d'ampleur variable selon les aspects, illustre la nature intégrée de l'apprentissage de l'analyse littéraire. Les observations de l'automne 2024 montrent aussi que cette transformation n'est pas linéaire, mais complexe. Chaque dimension se développe en relation avec les autres, certaines progressant plus rapidement que d'autres.
Le portfolio guide la progression des élèves et permet un développement durable des savoirs, savoir-faire et savoir-être, tout en renforçant l'autonomie et le sentiment de compétence des élèves. Les apprenant·es qui progressent maintiennent leur engagement même après des résultats décevants. Ils et elles utilisent ces expériences comme tremplins d'apprentissage plutôt que comme sources de découragement. Cette résilience, étroitement liée à la motivation et à la régularité de l'engagement, crée un cercle vertueux où chaque défi devient une occasion de croissance.
Il ne faut pas se le cacher, l'approche du portfolio d'apprentissage est exigeante en termes de temps et d'organisation, mais elle peut être adaptée. Ma première expérimentation contenait 21 artefacts, ma deuxième 14 et à l'automne 2025 je l'avait ramenée à 9 productions. Ce qui est important – les principes clés : boucle de rétroaction continue, progression visible, autonomie croissante – peut être appliqués à plus petite échelle.
L'essentiel est de maintenir le cap sur le développement de l'autonomie et de la résilience des élèves. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H⇄IA:Ce
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 9 décembre 2024 · Révisé le 19 août 2025
Références
Bélec, C. et Doré, R. (2023). Une recherche collaborative pour renouveler l'enseignement de la littérature au collégial dans une optique de cohérence disciplinaire : l'intérêt d'une approche par compétence de la lecture. [Rapport de recherche PAREA]. Cégep Gérald-Godin et Cégep de Drummondville. [En ligne]
Martin, N. (2012). Conception d'un portfolio pour documenter le développement des compétences de l'élève au collégial [Essai de maîtrise en éducation, Université de Sherbrooke]. [En ligne]
Viau, R. (2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. ERPI.
À explorer
À explorer
Pour comprendre la base du dispositif :
- 18‣ Exploiter le portfolio (1/3) - structure et contenu - La structure des 14 artefacts et les trois patterns de consolidation qui révèlent l'importance de l'engagement régulier et de la réflexion métacognitive
Pour voir l'impact sur la motivation :
- 15‣ Encourager la prise de risque - Comment la PAN transforme la motivation selon Viau : 82% des élèves rapportent se sentir plus confiants, créant la "boucle de croissance" qui encourage la prise de risque intellectuel
Pour comprendre les stratégies spécifiques :
- 17‣ Enseigner des stratégies - L'enseignement explicite des méthodes de lecture, rédaction, révision et métacognition dont l'application systématique constitue le deuxième facteur clé de réussite
Pour voir l'aboutissement du processus :
- 20‣ Exploiter le portfolio (3/3) - métacognition et autonomie - Le développement métacognitif comme quatrième facteur de réussite : comment la conscience des processus d'apprentissage transforme l'élève en apprenant autonome et résilient