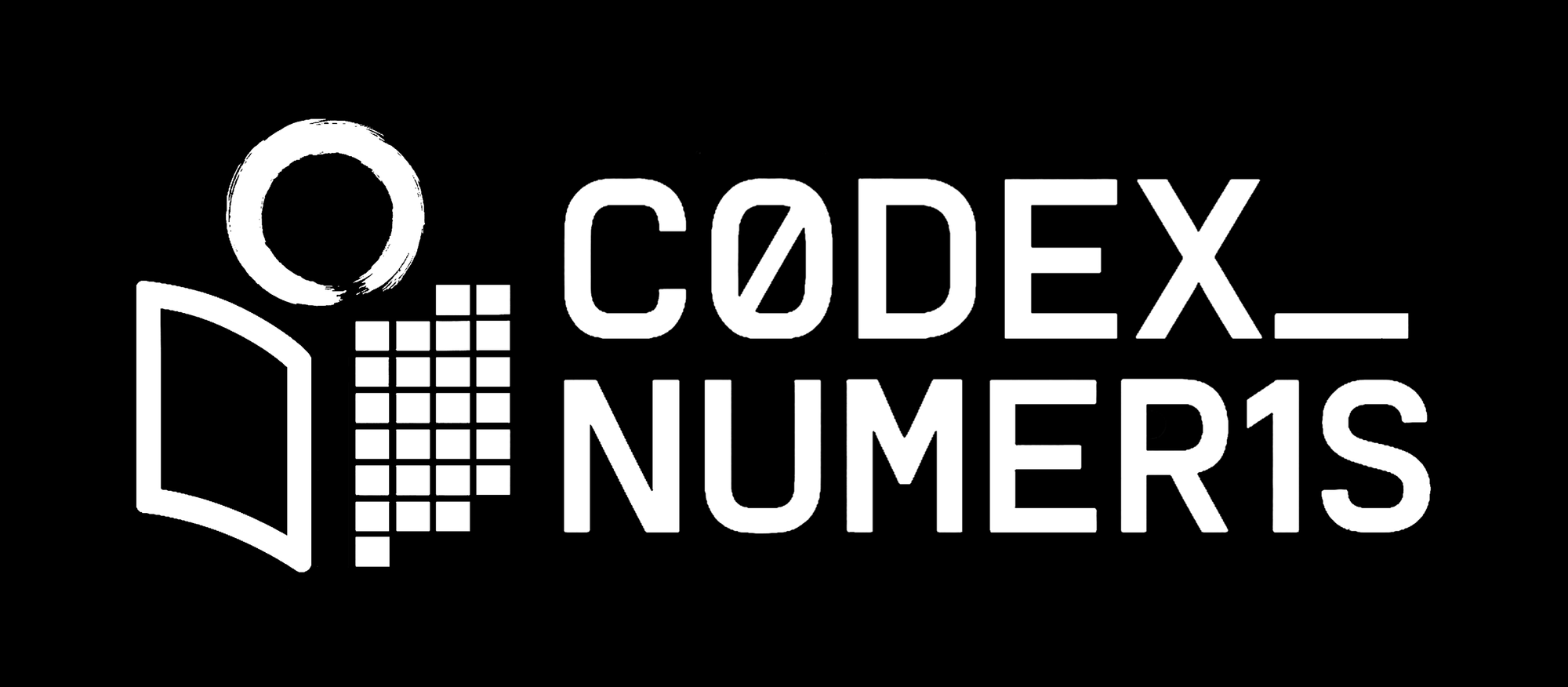33‣ Penser par soi-même dans un groupe
Comment se maintient notre capacité de jugement autonome dans un groupe ? Des expériences en psychologie et des découvertes en neurosciences révèlent qu'un simple « allié » peut suffire à briser le conformisme.

Les expériences psychologiques sur la conformité sociale révèle des mécanismes fascinants. Elles éclairent comment les dynamiques de groupe peuvent littéralement altérer notre perception de la réalité. Dans un contexte où la pensée divergente devient importante pour l'innovation pédagogique, examinons comment créer des espaces protégés où l'autonomie intellectuelle peut résister aux pressions conformistes sans briser la cohésion collective.

Les mécanismes du conformisme et de la pensée de groupe
► UNE étude de Solomon Asch (1951) a cherché à comprendre dans quelles conditions les individus résistent ou se soumettent aux pressions de groupe, particulièrement lorsque celui-ci exprime un avis contraire à l'évidence perceptive. Ce pionnier de la psychologie sociale a mis en place un protocole où un sujet devait réaliser une tâche simple et objective : comparer la longueur d'une ligne étalon avec trois autres lignes. Le sujet était placé dans un groupe de huit personnes, mais il ignorait que les sept autres étaient des complices de l'expérimentateur, programmés pour donner unanimement des réponses manifestement erronées.
Si certains participants maintiennent totalement leur indépendance face au groupe, d'autres se conforment presque systématiquement. Les résultats sont assez frappants : face à une majorité unanime donnant une réponse visiblement fausse, 32% des réponses des sujets s'alignent sur l'erreur du groupe. Asch a identifié trois types de réactions chez les sujets qui résistent. Certains s'appuyaient avec assurance sur leur perception, maintenant fermement leur position. D'autres restaient indépendants tout en cherchant à éviter le conflit. Enfin, un troisième groupe maintenait son jugement, mais avec tension et hésitation.
Plus précisément, du côté des sujets qui se conformaient, Asch a observé trois autres mécanismes distincts : une rare distorsion réelle de la perception (où le sujet finissait par voir comme le groupe), une plus fréquente distorsion du jugement (où le sujet doutait de sa propre perception), et enfin une distorsion de l'action (où le sujet, tout en maintenant intérieurement sa perception correcte, choisissait de se conformer publiquement).
Une majorité de trois personnes unanimes s'avérait plus efficace pour induire le conformisme qu'une majorité de huit personnes comprenant un dissident. La présence d'un seul «allié» qui donnait la réponse correcte suffisait à réduire le conformisme. Cette découverte suggère que les effets de groupe ne sont pas une simple addition d'influences individuelles, mais dépendent beaucoup de la dynamique relationnelle du groupe.
Les résultats de cette recherche sont fascinants. Ils éclairent les mécanismes subtils par lesquels les groupes peuvent influencer la perception et le jugement des individus, tout en montrant aussi leur capacité à maintenir leur indépendance face à la pression sociale. Ils soulignent notamment l'importance d'avoir ne serait-ce qu'un seul allié pour résister à la pression conformiste d'une majorité.
La pensée divergente – cette capacité à percevoir des solutions non conventionnelles ou à anticiper des changements nécessaires – peut s'avérer à la fois un atout et un défi dans un groupe. Dans des périodes de transformation majeure, cette forme de pensée est aussi précieuse que potentiellement dérangeante.
Mimétisme et altération du jugement
Plus tard, Deutsch et Gerard (1955) ont approfondi notre compréhension de ces mécanismes sociaux. Leurs expériences a permis de distinguer deux formes de mimétisme social. D’abord, «le conformisme normatif – le besoin de se conformer à ce qui est ou semble être la norme d'un groupe» (Nadal dans Collins, Andler, et Tallon-Baudry, p. 128) peut expliquer pourquoi certaines idées divergentes, mais pertinentes, peuvent être systématiquement minimisées. Elles dérogeraient trop aux façons de faire établies. De l'autre côté, «le mimétisme informationnel» est cette tendance à suivre l'opinion majoritaire en présumant que les autres ont une meilleure information que soi.
Ces expériences montrent que «la perception elle-même peut être affectée par l'avis des autres». Elles montrent que «lorsque le jugement personnel s'oppose à celui du groupe : il n'y a pas qu'un examen « froid » des informations disponibles pour en déduire la décision à prendre, mais aussi une réaction émotionnelle à la dissonance cognitive que provoque un conflit avec le groupe.» (Nadal dans Collins, Andler, et Tallon-Baudry, p. 128).
Ce n'est pas tant que des membres d’un groupe choisissent consciemment d'ignorer certaines idées ou perspectives – les dynamiques de groupe peuvent avoir littéralement altéré leur capacité à les percevoir objectivement. Des études récentes en neuro-imagerie ont montré que l'avis du groupe peut littéralement modifier notre perception. Notre cerveau peut réellement altérer la façon dont nous percevons la réalité pour l'aligner avec l'opinion dominante. C'est fou, non ?
La pensée divergente comme vecteur de changement
Le contraste entre la réception externe et interne de certaines idées n'est pas tant une question de qualité ou de pertinence qu'une manifestation de puissants mécanismes sociaux et cognitifs. À l'extérieur, sans la pression du groupe, les individus peuvent évaluer certaines idées sur leur mérite propre. En interne, les dynamiques de conformisme créent un filtre qui déforme systématiquement cette évaluation et présente la divergence comme une menace à l’ordre du groupe.
Les mécanismes de défense peuvent particulièrement se manifester dans les groupes de taille moyenne (20-30 personnes), où les dynamiques interpersonnelles sont suffisamment complexes pour créer des effets de groupe, mais assez restreintes pour maintenir une pression sociale. Dans un conseil d'administration, un comité, une équipe de travail ou un département, on peut observer comment une opinion devient progressivement dominante, non pas nécessairement par sa pertinence, mais par les mécanismes de conformisme social.
La défense du «territoire intellectuel» ou professionnel face aux idées nouvelles est quelque chose de connu dans la résistance au changement organisationnel. Ce phénomène repose sur différents biais cognitifs.
Les mécanismes de perpétuation des biais collectifs
Kahneman (2012) a remis en cause la «vision trop rationnelle et logique de l'intelligence, en démontrant que nos jugements et décisions sont le plus souvent dominés par des heuristiques intuitives, très rapides, fondées sur des biais cognitifs erronés» (Houdé, p. 8). «Dans le cerveau, une heuristique est une stratégie très rapide, très efficace [...] qui marche très bien, très souvent mais pas toujours, à la différence de l'algorithme exact, plus lent et réfléchi» (Houdé, p. 18).
Trois de ces biais, en particulier, peuvent interagir pour créer ce qu'on pourrait appeler un «verrouillage cognitif» particulièrement puissant dans les dynamiques de groupe.
L'effet de halo crée d'abord un filtre perceptif qui influence l'interprétation de toute nouvelle information. Une fois qu'une impression générale est établie au sein du groupe, elle peut teinter systématiquement l'évaluation des nouvelles idées. Ce filtre initial est ensuite renforcé par le biais de confirmation, qui pousse le groupe à ne retenir que les informations confirmant cette première impression, tandis que les éléments contradictoires sont minimisés ou carrément ignorés. Enfin, la prophétie auto-réalisatrice, concept développé par Merton (1948), vient compléter ce cycle en montrant comment ces attentes collectives influencent activement les interactions de manière à confirmer ces mêmes attentes : les membres du groupe, conditionnés par leurs biais initiaux, adoptent des comportements qui provoquent en retour des réactions défensives, renforçant ainsi leur conviction initiale.
L'interaction de ces trois mécanismes crée une situation où les biais se perpétuent et se renforcent mutuellement, indépendamment de leur validité initiale. Cette dynamique est particulièrement difficile à briser car elle s'auto-alimente : chaque nouvelle interaction avec une pensée divergente est interprétée à travers le prisme des attentes existantes, créant un cercle vicieux qui peut persister même face à des preuves contraires. Ce verrouillage cognitif explique pourquoi certaines idées, perspectives ou alternatives peuvent être systématiquement ignorées en dépit de leur pertinence.
Ceci soulève des questions fondamentales sur la façon dont les groupes gèrent la différence. Comment maintenir un équilibre entre la cohésion nécessaire d'une équipe et l'apport créatif de perspectives divergentes ? Comment créer des espaces où l'innovation peut émerger sans être immédiatement étouffée par les mécanismes de conformisme que nous avons explorés précédemment ?
Tension, résistance, exclusion
La disruption technologique actuelle, particulièrement l'émergence de l'intelligence artificielle, illustre très bien cette dynamique. Elle crée une tension palpable dans de nombreux milieux professionnels (en santé ou en éducation par exemple), tension qui ne reflète pas simplement une résistance au changement technologique, mais révèle des oppositions plus profondes dans notre façon d'envisager la transformation des pratiques.
Ce qui rend particulièrement complexe la gestion du changement, c'est que la résistance n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Parfois, plus une transformation semble inévitable, plus elle peut susciter des mécanismes de défense qui sont forts. Plus les impacts potentiels deviennent évidents, plus les réactions défensives s'intensifient, renforçant les mécanismes de conformisme et de résistance.
Or, l'enjeu n'est pas simplement de protéger la pensée divergente face aux mécanismes du conformisme social, mais de préserver les espaces nécessaires à l'innovation et l'adaptation. Une «écologie de la pensée divergente» ne vise pas à imposer le changement, mais à créer les conditions où l'innovation peut émerger naturellement.
Les expériences d'Asch et les travaux ultérieurs en psychologie sociale nous rappellent une leçon essentielle : la présence d'un seul allié peut suffire à maintenir notre capacité de jugement face à une majorité unanime.
Dans cette optique, les communautés de pratique peuvent peuvent non seulement valider des pratiques alternatives et construire des espaces d’innovations nécessaires, mais aussi favoriser des réseaux de soutien et d’échange entre enseignant·es divergent·es. et constituer un remède précieux au conformisme local. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H⇄IA:Ce
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 23 février 2025 · Révisé le 22 août 2025
Références
Anctil, D. (2023). L'éducation supérieure à l'ère de l'IA générative. Pédagogie collégiale, 36(3), 66-76. [En ligne]
Asch, S. E. (1951). Influence interpersonnelle : Les effets de la pression de groupe sur la modification et la distorsion des jugements. Dans C. Faucheux & S. Moscovici (Éds.), Psychologie sociale théorique et expérimentale (P. Nève, Trad., pp. 235-245). Mouton. (Ouvrage original publié en 1951) [En ligne]
Boucher, J.-P. (2023). ChatGPT : la riposte doit être pédagogique. Pédagogie collégiale, 36(3), 77-82. [En ligne]
Collins, A., Andler, D., & Tallon-Baudry, C. (2018). La cognition : Du neurone à la société. Gallimard.
Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(3), 629-636.
hooks, b. (2019). Apprendre à transgresser : L'éducation comme pratique de la liberté (M. Cornillot, Trad.). Éditions Syllepse. (Ouvrage original publié en 1994)
Houdé, O. (2022). Apprendre à résister : Pour combattre les biais cognitifs (Éd. augmentée). Flammarion.
Kahneman, D. (2012). Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée (R. Clarinard, Trad.). Flammarion. (Ouvrage original publié en 2011)
Merton, R. K. (1948). The self-fulfilling prophecy. The Antioch Review, 8(2), 193-210. [En ligne]
Rosenthal, R. (1966). Experimenter effects in behavioral research. Appleton-Century-Crofts. [En ligne]
À explorer
Pour comprendre les fondements neurologiques de la résistance :
- 43‣ Réveiller les neurones endormis - Comment développer une «pédagogie de la résistance cognitive» face à la facilité technologique, essentielle pour maintenir l'autonomie intellectuelle dans les groupes
Pour saisir les forces qui menacent la pensée autonome :
- 32‣ Tenir le coup face à la disruption - Comment la disruption utilise la vitesse pour contourner les mécanismes démocratiques et pourquoi l'école doit préserver les espaces de pensée authentique
Pour créer un environnement propice à la pensée divergente :
- 40‣ Concevoir la classe comme un écosystème d'intelligence - Comment transformer la dynamique de groupe en privilégiant les boucles de rétroaction qui favorisent l'émergence plutôt que le conformisme
Pour transformer les organisations en écosystèmes résilients :
- 41‣ Penser l'écologie de nos organisations - Comment appliquer les principes de permaculture organisationnelle pour cultiver l'autorégulation et l'intelligence collective.