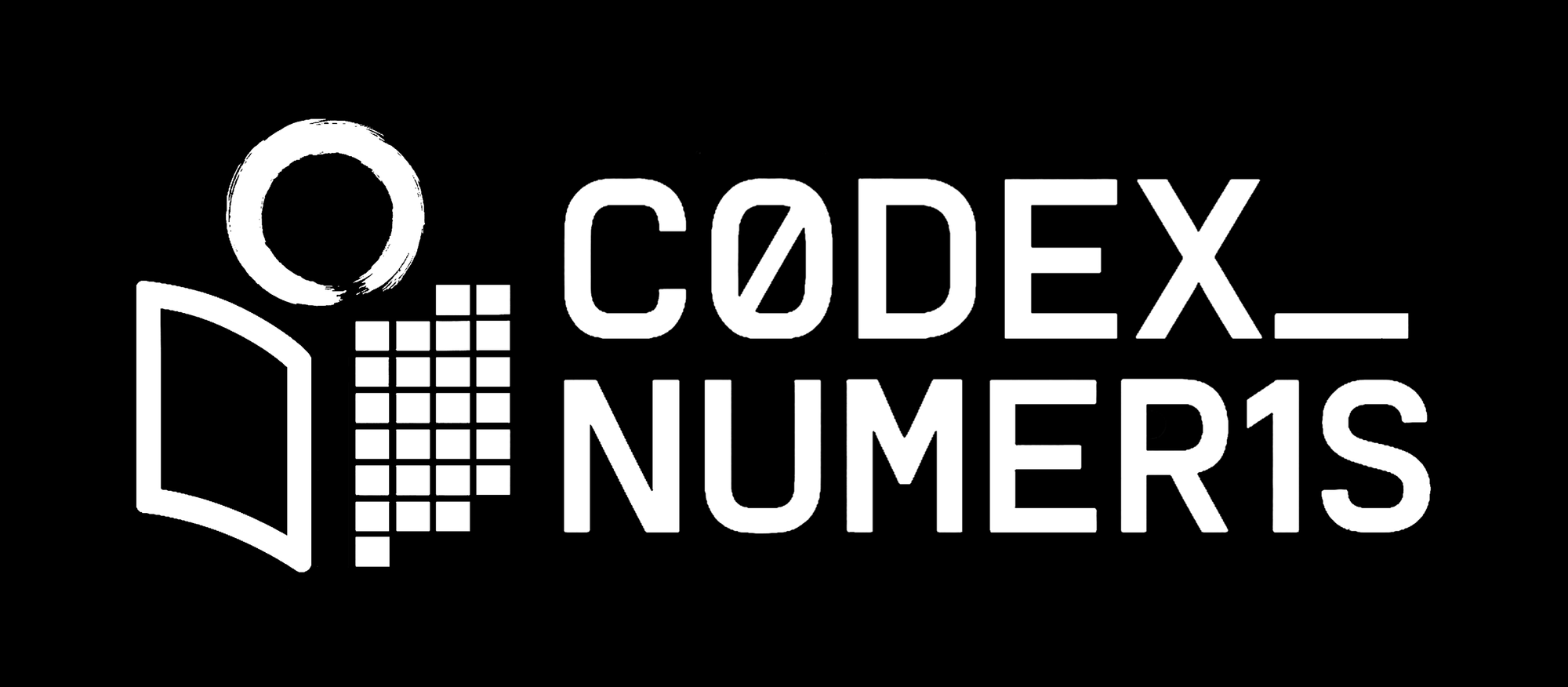30‣ Agir sur les inégalités scolaires
Comment briser concrètement les mécanismes invisibles qui reproduisent les inégalités dans nos classes ? Et si l'enseignement explicite était cette pédagogie « rationnelle » qui peut contrer la violence symbolique du système éducatif en rendant visible l'invisible ?

Les inégalités ne sont pas une fatalité, mais le fruit de processus sur lesquels l'enseignant·e peut agir. Un enseignement explicite et une relation pédagogique bienveillante peuvent répondre à ce que Bourdieu appelait la «violence symbolique». Une pédagogie «rationnelle», qui rend visible l'invisible, offre un levier concret pour briser la reproduction des inégalités du système éducatif.

► QUAND j'ai vu les statistiques la première fois, j'ai compris qu'il y avait derrière la réalité de ma classe des mécanismes invisibles qui sont forts et implacables.
Le poids des inégalités scolaires
À Drummondville, comme dans plusieurs autres régions du Québec, 40% des écoles primaires et secondaires sont en milieux défavorisés. On compte 14 écoles sur 35 avec un indice de milieu socio-économique (IMSE) de 8 ou plus sur une échelle de 10. La moyenne est de 7,2 dans la région.
Dans ma classe, plus précisément dans mon cours 101 «hors-séquence» en littérature (H2024), les données montrent une surreprésentation marquée des étudiants de première génération au cégep (EPGC), c'est-à-dire les élèves qui sont les premiers de leur famille à accéder aux études collégiales. Ils constituent environ 30% de la population générale du Cégep de Drummondville, mais ici le taux monte à 56%. Cette surreprésentation est encore plus prononcée dans le sous-groupe des étudiants issus du cours de renforcement en français, où la proportion d'EPGC atteint 60%.
On peut expliquer cette réalité par la convergence de plusieurs facteurs, autant socioculturels que systémiques. D'abord, le capital culturel et scolaire familial est moins aligné sur les attentes de l'enseignement supérieur. Dans la région du Centre-du-Québec, près de 65% de la population n'a pas complété d'études collégiales.

À ces défis s'ajoutent des facteurs psychosociaux comme l'absence de modèles familiaux ayant navigué dans au cégep ou à l'université, ce qui peut affecter le sentiment d'efficacité personnelle et augmenter l'anxiété face aux études supérieures. La situation se complexifie davantage pour les EPGC issus de l'immigration, nombreux dans mes groupes, qui doivent non seulement s'approprier les codes culturels et académiques québécois, mais qui doivent aussi parfois composer avec des variations linguistiques significatives, même si le français est leur langue première.
Des études sociologiques montrent que les étudiants de première génération au cégep font face à des défis particuliers : moins de soutien parental pour leurs études, risque accru d'interruption du parcours scolaire, sentiment d'appartenance plus faible au milieu académique et importance accordée à l'emploi parallèlement aux études (Bonin, 2015). Or, on estime qu’«environ un tiers des enfants ne sont pas préparés à l'entrée à l'école puisqu'ils présentent des lacunes dans des domaines associés à la réussite éducative» (Mousseau, p. 4).
Ces statistiques ne sont pas que des chiffres : elles révèlent des mécanismes de reproduction sociale qui sont réels et profonds et que le sociologue Pierre Bourdieu nommait la «violence symbolique» du système éducatif. Comme l'explique Adelino Braz (2011), qui a consacré deux ouvrages à Bourdieu et l'éducation, l'école opère «une opération de tri qui permet de maintenir l'ordre social préexistant, en favorisant et séparant les détenteurs de capital culturel hérité de ceux qui en sont dépourvus» (p. 20).
Cette violence symbolique s'exerce de façon particulièrement efficace parce qu'elle ne se présente jamais comme telle. Elle apparaît plutôt comme un discours légitime qui normalise la réalité, comme un ordre qui semble «naturel», alors qu'il s'agit en réalité d'un arbitraire culturel. Et parfois les enseignants perpétuent ces normes par leurs pratiques, à leur insu. En pensant bien faire.
Je l'ai fait. Longtemps. Sans savoir.

L'ancrage des inégalités est profond. Sa reproduction remonte loin en arrière. Comme l'explique Braz, «chaque agent social hérite, par son entourage familial et le groupe social auquel il appartient, d'un capital linguistique et de schèmes de pensée. L'apprentissage de la langue [...] s'accomplit, dans un premier temps, à partir des échanges au sein d'une famille qui elle-même occupe une position particulière dans l'espace social» (Braz, 2013, p. 157).
Les recherches récentes (Mousseau, 2018) montrent comment la relation étroite entre la scolarité maternelle et le développement langagier de l'enfant est marquante. Elle conditionne l'ensemble du parcours scolaire. «En l'absence d'un vrai travail de verbalisation, les élèves ayant un capital linguistique modeste sont condamnés à restituer un langage inadapté ou artificiel, sans être en mesure d'assimiler les catégories de pensée susceptibles de leur permettre de répondre aux exigences culturelles imposées par l'école elle-même» (Braz, 2013, p. 126).
Est-ce dire que tout cet implicite est inévitable ? Est-ce dire qu'on n'y peut rien ?
Dévoiler la mécanique, révéler les mécanismes
L'ordre social semble naturel, alors qu'il ne l'est pas du tout. Or, en ouvrant l'accès au code – culturel, scolaire, méthodologique – , l'enseignant·e a un pouvoir d'action dans sa classe qui peut être très émancipateur. Il peut avoir un impact majeur sur le sentiment d'appartenance au groupe et sur le sentiment de compétence des apprenants.
Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un enseignement «explicite». C'est une pédagogie qui montre, qui expose, qui dévoile le «comment faire» aux yeux de l'élève et lui remet les clés de son autonomie. L'enseignement explicite (ou direct) est né aux États-Unis en même temps que Bourdieu et Passeron dénonçaient le système scolaire français dans les années soixante. Une telle pédagogie doit notamment «éviter tout malentendu linguistique et méthodologique entre les professeurs et les étudiants, en explicitant les principes méthodologiques qu'il est nécessaire d'appliquer» (Braz, 2011, p. 152). C'est une pédagogie qui «œuvre au moyen de la raison et non plus par le biais du mythe ou de l'arbitraire culturel» (Braz, 2011, p. 154). L'enseignement explicite est une réponse particulièrement pertinente et concrète qui ouvre la voie à une véritable démocratisation de l'éducation.
Cette pédagogie «rationnelle», comme l’appelait Bourdieu, offre un levier d'action concret pour briser le cycle de la reproduction des inégalités. Son efficacité repose précisément sur sa capacité à rendre visible l'invisible – à expliciter ces «règles implicites multiples mises en œuvre inconsciemment par le corps enseignant» (Braz, 2011, p. 144).
Modélisation, pratique guidée, pratique autonome, rétroactions nombreuses ne sont que quelques astuces pour favoriser l’apprentissage, la confiance en soi et l'autonomie. Trop souvent, comme le souligne Braz (surtout dans le système français), «les critères de correction obéissent à des catégories professorales qui, au lieu de porter leurs jugements sur les éléments inhérents à la production scolaire, portent sur l'individu lui-même» (Braz, 2011, p. 128). L'enseignement explicite, en revanche, promeut un alignement constructif, une évaluation critériée qui porte sur des compétences clairement définies et explicitement enseignées. Des objectifs clairs, nommés, mis en pratique avec un accompagnement progressif.
L'enseignement explicite (ou efficace) s'aligne tout à fait avec ce que Bourdieu appelait une «pédagogie démocratique». Il «se donne pour fin inconditionnelle de permettre au plus grand nombre possible d'individus de s'emparer dans le moins de temps possible, le plus complètement et le plus parfaitement possible, du plus grand nombre possible des aptitudes qui font la culture scolaire à un moment donné» (Les Héritiers, 1964, cité dans Braz, 2011, p. 150).
L’éducabilité : première condition du changement
La mise en œuvre de l'enseignement explicite pose des défis importants : elle exige une planification méticuleuse, elle impose de ralentir la cadence pour être véritablement à l'écoute des élèves. Cependant, les bénéfices justifient largement cet investissement. Non seulement cette approche réduit les échecs, mais elle favorise aussi un apprentissage plus profond.
Tout commence par la relation entre l'enseignant·e et l'apprenant·e. Enseigner est une action sociale.

Comme le souligne le Référentiel pour guider l'intervention en milieu défavorisé, il s'agit, au départ, de «croire en l'éducabilité de tous» et en «notre capacité d'agir sur l'apprentissage» (p. 4). Croire en notre capacité d'agir sur les inégalités sociales en classe, en dehors de la classe et... entre les classes.
Cette conviction de l'éducabilité s'incarne aussi dans des initiatives originales comme le programme de l'École des grands, un exemple particulièrement éloquent qui vise à «prévenir et réduire la pauvreté par l’éducation». Cette approche éducative repose sur un système de mentorat qui met en relation des élèves du primaire issus de milieux défavorisés et des élèves du cégep qui sont volontaires et bénévoles pour les accompagner. Le programme met l’accent sur l’aide aux devoirs et l’éveil scientifique : chaque samedi matin, des enfants ont rendez-vous avec leurs mentors pour les accompagner dans réussite éducative. L’École des Grands soutient la réussite des élèves vulnérables du primaire afin de prévenir le décrochage scolaire au secondaire, mais soutient également la réussite des étudiant·es du cégep qui s’impliquent comme mentors, notamment celle des étudiant·es à risque de difficultés scolaires.
Les mesures d'impact effectuées par la Fondation W., qui chapeaute l'École des grands, révèlent que les résultats scolaires des élèves du primaire qui participent au programme ont tendance à augmenter en français, en mathématiques et en sciences. Les retombées sont aussi visibles chez les collégiens à risque. Chez les deux groupes (primaire et collégial), on voit des effets sur l’engagement, l’autonomie et la motivation intrinsèque à l’école.
Depuis sa création, il y a dix ans, 1505 élèves du primaire et 1343 étudiant.e.s du post-secondaire ont bénéficié du soutien de l’École des grands. Plus d’une vingtaine de cégeps participent à cette initiative en 2025.
La réalité est le fruit d’une histoire et de forces sociales, politiques et économiques qui ne sont pas fixes. Comme le soulignait Bourdieu, la sociologie n'est pas une «science du désenchantement» mais une science qui «défatalise» en rendant visible le code. Les inégalités scolaires sont le résultat de processus sur lesquels nous pouvons agir concrètement.
Et nous pouvons changer les choses dès que nous jetons la lumière sur la façon dont nous les faisons. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 27 janvier 2025 · Révisé le 23 août 2025
Références
Bonin, S., Duchaine, S., & Gaudreault, M. (2015). Portrait socioéducationnel des étudiants de première génération. Projet interordres sur l'accès et la persévérance aux études supérieures des étudiants de première génération. Québec : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. [En ligne]
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2012). Les Héritiers : les étudiants et la culture. Les Éditions de Minuit. (Ouvrage original publié en 1964)
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2018). La Reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement. Les Éditions de Minuit. (Ouvrage original publié en 1970)
Braz, A. (2011). Bourdieu et la démocratisation de l'éducation. Presses Universitaires de France.
Braz, A. (2013). Apprendre à philosopher avec Bourdieu. Ellipses.
Cégep de Drummondville. (2024). Plan stratégique 2024-2029 - Un cégep engagé et solidaire, générateur de transformations éducatives, sociales et environnementales. Drummondville. [En ligne]
Conseil supérieur de l'éducation. (2016). Remettre le cap sur l'équité : rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2014-2016. Gouvernement du Québec. [En ligne]
Fondation W. (2024). La réussite éducative pour tous, Rapport annuel 2024. [En ligne]
Institut de la statistique du québec. (2024). Panorama des régions du Québec. Édition 2024. Gouvernement du Québec. [En ligne]
Ministère de l'éducation. (2024). Indices de défavorisation des écoles publiques 2023-2024. Direction des indicateurs et statistiques, Direction générale de la valorisation de l'information, Secteur Numérique et Information. Gouvernement du Québec. [En ligne]
Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur (2019). Référentiel pour guider l'intervention en milieu défavorisé. Gouvernement du Québec. [En ligne]
Mousseau, M. (2018). Liens entre l'augmentation de la scolarité des mères, les trajectoires d'adaptation psychosociale des enfants et les pratiques parentales [Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal]. [En ligne]
À explorer
Pour découvrir l'application concrète de la «pédagogie rationnelle» :
- 27‣ Pratiquer l'enseignement explicite - Cette chronique illustre comment «rendre visible l'invisible» par la modélisation, la pratique guidée et l'autonomie progressive, démontrant concrètement comment cette approche démocratise l'accès aux processus cognitifs en explicitant ce qui reste habituellement implicite.
Pour comprendre le cadre systémique d'intervention :
- 34‣ Appliquer le modèle de la Réponse à l'intervention (niveau 1) - Cette chronique présente l'enseignement universel de qualité qui vise à faire réussir 80-90% des élèves, montrant comment structurer systématiquement les meilleures pratiques pour réduire la corrélation entre origine sociale et résultats scolaires.
Pour saisir les outils de dépistage précoce :
- 1‣ Monitorer l'apprentissage - Cette chronique révèle comment identifier rapidement les élèves à risque par des données objectives plutôt que des impressions, permettant des interventions préventives qui contrent les mécanismes de reproduction des inégalités avant qu'ils ne se cristallisent.
Pour voir l'enseignement explicite des stratégies :
- 17‣ Enseigner des stratégies - Cette chronique détaille comment enseigner explicitement les stratégies cognitives selon une progression du simple au complexe, offrant à tous les élèves, indépendamment de leur capital culturel familial, l'accès aux outils méthodologiques essentiels à la réussite scolaire.