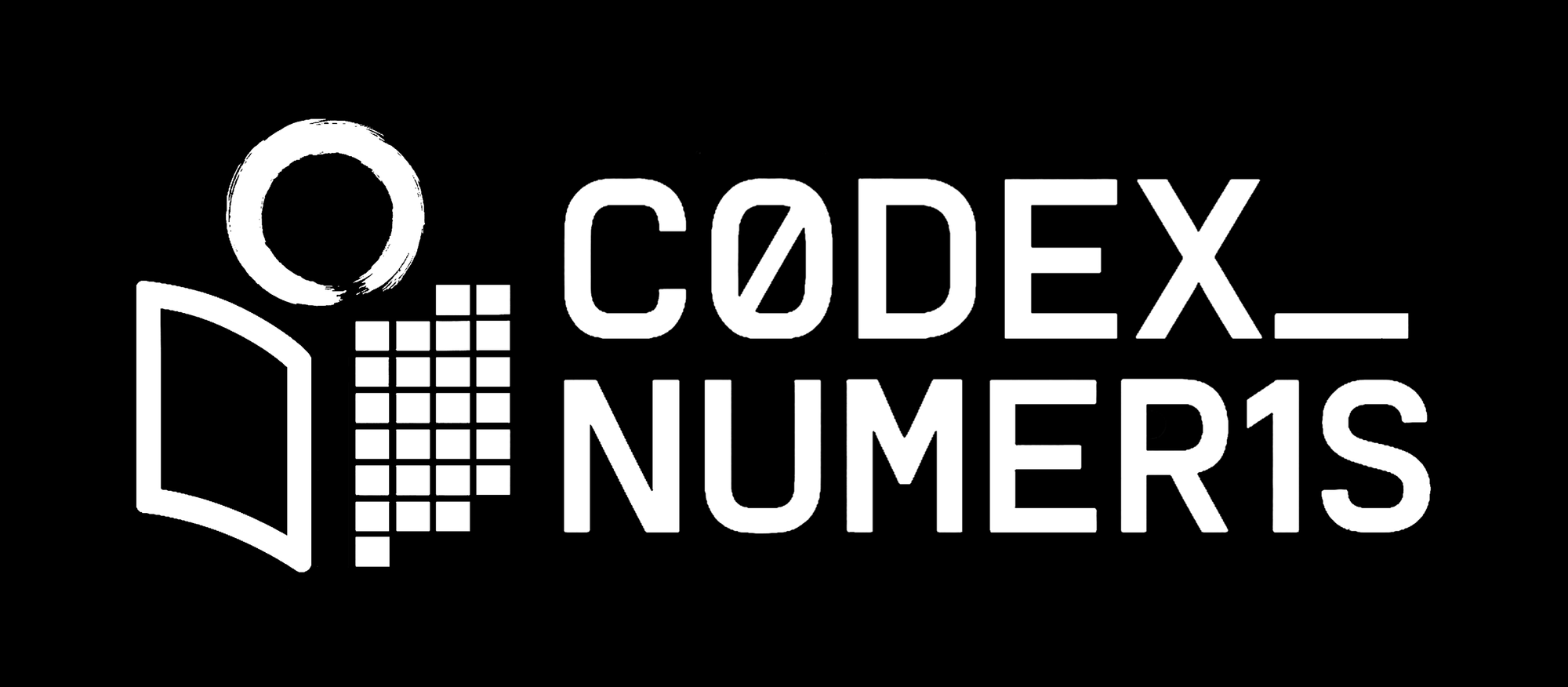22‣ Voir la tricherie autrement
Comment la tricherie pourrait-elle être le symptôme d'une difficulté plutôt qu'une faute morale à sanctionner ? Et si je pouvais, par ma réponse, enseigner un comportement positif ?

La tricherie – avec ou sans l'IA – est une situation qui cause parfois beaucoup d'émotions à l'enseignant·e : colère, déception, tristesse. Mais peut-être aussi qu'elle est la conséquence de celles de l'apprenant·e – la peur de l'échec, la démotivation, la résignation. Et si la tricherie était le symptôme d'une difficulté plutôt qu'une faute morale à sanctionner ?

« Réduire la tricherie est une bonne chose, mais nous devons aussi repenser nos standards, ce que nous espérons vraiment enseigner » (Bowen & Watson, 2024, p. 133).
► COMME bien des collègues, il m'est arrivé moi aussi, de découvrir que certaines productions de mes élèves n'étaient pas de leur cru. Parfois, les indices d'une utilisation de l'IA générative sont évidents – un compte-rendu de roman avec des personnages qui n'existent pas – parfois, c'est plus subtil – l'utilisation d'une syntaxe particulièrement fluide et d'un vocabulaire recherché... absents des autres rédactions.
J'ai moi-même déjà triché quand j'étais au secondaire. Une amie m'a payé pour faire son travail en histoire. Nous n'avions rien contre l'enseignant. C'est simplement que l'apprentissage associé à cette production avait peu de valeur à nos yeux. D'où vient cette valeur ? Pourrait-on voir plus clair dans la situation en y mettant un peu de bienveillance ? Ce petit pas de recul sur la situation m'a amené à voir la tricherie autrement.
Les émotions, les besoins
La tentation est grande de voir la technologie comme une menace pour l'intégrité académique. À chaque fois, l'enseignant·e qui se découvre «cocufié·e par l'IA» vit une émotion particulièrement désagréable. Au début, de la déception, de la colère. Le sentiment d'avoir été trahi·e. Mais si je mets de côté la menace à mon ego, je me rends compte que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. L'affaire est beaucoup plus subtile que les apparences et, souvent, mon ego n'a absolument rien à y voir. Peut-être que cette «crise» nous offre l'opportunité de repenser fondamentalement notre relation pédagogique avec l'apprenant·e.
Les motivations qui poussent un·e élève à tricher sont complexes et interdépendantes. Les recherches en motivation scolaire montrent que c'est rarement un choix délibéré de malhonnêteté, mais plutôt une réponse à différentes formes de détresse. Une lourde charge cognitive peut décourager. La peur de l'échec, particulièrement intense chez une population étudiante qui a déjà vécu des expériences scolaires difficiles, peut paralyser la capacité à s'engager authentiquement dans l'apprentissage. L'inverse existe aussi : l'anxiété de performance peut pousser à franchir l'interdit. De plus, comme le soulignent Lieury et Fenouillet, un·e élève qui considère l'effort comme dévalorisant aura tendance à développer des stratégies d'évitement. À cela s'ajoute parfois une déconnexion profonde avec la matière enseignée : quand l'élève ne perçoit pas la valeur ou l'utilité des apprentissages proposés, la tentation de prendre des raccourcis s'accroît.
L'apprentissage, comme toute relation significative, est profondément ancré dans l'émotion. Les recherches en sciences cognitives montrent que les émotions ne sont pas simplement des états d'âme passagers, mais des signaux importants. Comme l'explique Monique Boekaerts (2010), «les émotions signalent qu'un écart par rapport à la norme préétablie a été détecté» et «ce signal doit être interprété comme la nécessité d'un changement d'attitude» (p. 101). Or, cette dimension émotionnelle est particulièrement visible dans la relation pédagogique. Le lien qui unit l'enseignant·e et l'apprenant·e est fait d'attentes, d'espoirs et parfois de déceptions.
Cette approche s'aligne avec les récentes recherches sur la bienveillance en contexte scolaire. Comme le démontrent Shankland et ses collaborateurs (2018), la bienveillance n'est pas une simple disposition affective, mais une véritable compétence socio-émotionnelle qui comporte trois dimensions essentielles : cognitive (l'attitude de non-jugement et d'ouverture), affective (l'empathie et la compassion) et comportementale (le maintien d'un cadre adapté aux besoins des élèves).
Les recherches de Ryan et Deci (2000) sur l'autodétermination ont montré que trois besoins psychologiques fondamentaux doivent être satisfaits chez un individu : le besoin d'autonomie, de compétence et de proximité sociale. Et si c'était l'insatisfaction de ces besoins chez l'apprenant·e qui était une cause de la «difficulté» ?
Quand les liens entre les activités pédagogiques et les besoins fondamentaux deviennent flous, l'apprentissage peut sembler perdre en valeur. La relation pédagogique peut se fragiliser.
L'anatomie d'une rupture
La trajectoire est similaire à celle d'une relation amoureuse qui se détériore :
- D'abord, la motivation s'émousse face aux premières difficultés.
- Puis, les petits échecs non résolus créent une distance.
- Enfin, l'étudiant cherche des «solutions» pour maintenir l'apparence d'une relation qui est déjà rompue.
Pour mieux comprendre ce processus émotionnel chez l'enseignant·e, on pourrait être tenté de faire un parallèle avec le modèle des «cinq étapes du deuil» proposé par Elisabeth Kübler-Ross. Cette psychiatre a initialement développé ce cadre en 1969 pour décrire les réactions émotionnelles des patients en phase terminale, et non comme une théorie universelle du deuil ou du changement. Comme elle l'a elle-même précisé dès 1974 dans son second ouvrage «Questions & Answers on Death and Dying», ces étapes n'étaient pas conçues comme un processus linéaire : plusieurs peuvent survenir simultanément, certaines peuvent être absentes et leur ordre n'est pas fixe.
Ce modèle n'a pas reçu de validation scientifique formelle, mais il offre néanmoins un vocabulaire utile pour décrire et comprendre les réactions émotionnelles face aux changements importants. Dans le contexte de la tricherie, on peut observer chez l'enseignant·e des réactions qui rappellent ce processus d'adaptation.
- Le déni : «Ce n'est pas possible, cet élève ne peut pas avoir triché, il ou elle était si engagé·e dans le cours...» Cette première réaction protège temporairement l'enseignant·e du choc émotionnel que représente la rupture du lien de confiance.
- La colère : L'enseignant·e peut ressentir une profonde colère, non seulement envers l'élève, mais aussi envers la technologie, le système éducatif, voire lui-même : «Comment a-t-on pu me faire ça ? J'ai investi tant d'efforts pour l'aider...», «Où s'en va-t-on ? C'est une vraie déperdition morale !» Cette colère masque souvent un sentiment de trahison et de déception.
- La négociation et le marchandage : L'enseignant·e tente de trouver des compromis : «Si je lui donne une seconde chance...», «Si je modifie mes évaluations...», «Si j'avais fait autrement...» Cette étape révèle le désir de maintenir la relation pédagogique malgré la rupture.
- La dépression : Une période de questionnement profond peut survenir : «À quoi bon enseigner si les élèves peuvent tout faire faire par l'IA ?», «Quel est encore mon rôle ?» Nous voilà partis pour remettre en question l'identité professionnelle.
- L'acceptation : Finalement, l'enseignant·e peut atteindre une compréhension plus nuancée : «Comment puis-je transformer cette expérience en opportunité d'apprentissage pour moi ?», «Comment repenser ma pédagogie face à ces nouveaux défis ?»
Repartir sur de nouvelles bases
Voir la tricherie avec bienveillance nous permet de la considérer non pas comme une faute morale à sanctionner, mais comme un signal d'alarme – le symptôme d'une situation difficile, que l'on reconnaît, et à laquelle on a maladroitement cherché une issue. Je ne suis pas la cause de la tricherie. Pourquoi mon élève a-t-il ou a-t-elle choisi cette voie ? Quelles sont ses motivations ? Quelles sont ses émotions – ses craintes, ses inquiétudes ?
Comme enseignant·e, j'ai encore une influence sur la situation : je peux adopter et promouvoir une attitude plus nuancée, moins impulsive et émotive, plus rationnelle et posée – bref : plus critique. Je peux favoriser ce comportement positif en l'incarnant. Mais je dois d'abord le comprendre. Je dois d'abord admettre, avec honnêteté, que je peux apprendre de cette situation.
Après la «crise», il reste à reconstruire la relation de confiance sur de nouvelles bases plus solides. Car au fond, comme dans toute relation significative, ce n'est pas la surveillance qui crée la confiance, mais la confiance qui rend la surveillance inutile. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 16 décembre 2024 · Révisé le 28 août 2025
Références
Boekaerts, M. (2010). Motivation et émotion : deux piliers de l'apprentissage en classe. Dans H. Dumont, D. Istance et F. Benavides (dir.), Comment apprend-on ? La recherche au service de la pratique (p. 97-119). Éditions OCDE.
Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying. Macmillan.
Lieury, A., & Fenouillet, F. (2019). Motivation et réussite scolaire (4e éd.). Dunod.
Moreau, P. (2024). «La tricherie en croissance et en mutation», Le Devoir, 14 décembre 2024. [En ligne]
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
Shankland, R., Bressoud, N., Tessier, D., & GAY, P. (2018). La bienveillance : une compétence socio-émotionnelle de l'enseignant·e au service du bien-être et des apprentissages ? Questions Vives, 29.
Viau, R. (2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. ERPI.
Wilson, D., & Conyers, M. (2020). Five Big Ideas for Effective Teaching: Connecting Mind, Brain, and Education Research to Classroom Practice (2e éd.). Teachers College Press.
À explorer
Pour découvrir une approche concrète d'évaluation bienveillante :
- 5‣ Mettre en place une pratique alternative de notation (PAN) - La mise en œuvre pratique d'un système d'évaluation qui transforme l'erreur en opportunité d'apprentissage et reconstruit la confiance par des jetons de reprise et une échelle qualitative
Pour comprendre l'impact émotionnel de la transformation évaluative :
- 21‣ Alléger la charge de l'évaluation - Comment la redéfinition du rapport à l'erreur libère tant l'enseignant que l'élève du fardeau émotionnel traditionnel de l'évaluation et favorise un environnement d'apprentissage plus sain
Pour développer l'autorégulation dans la relation pédagogique :
- 36‣ S'autoréguler - Les stratégies concrètes pour maintenir son équilibre émotionnel et cognitif tout en cultivant la bienveillance nécessaire à la reconstruction des liens de confiance avec les élèves
Pour adopter une vision systémique des relations d'apprentissage :
- 40‣ Concevoir la classe comme un écosystème d'intelligence - L'approche des stocks et flux émotionnels/cognitifs qui éclaire les dynamiques relationnelles complexes au cœur de la reconstruction de la confiance pédagogique