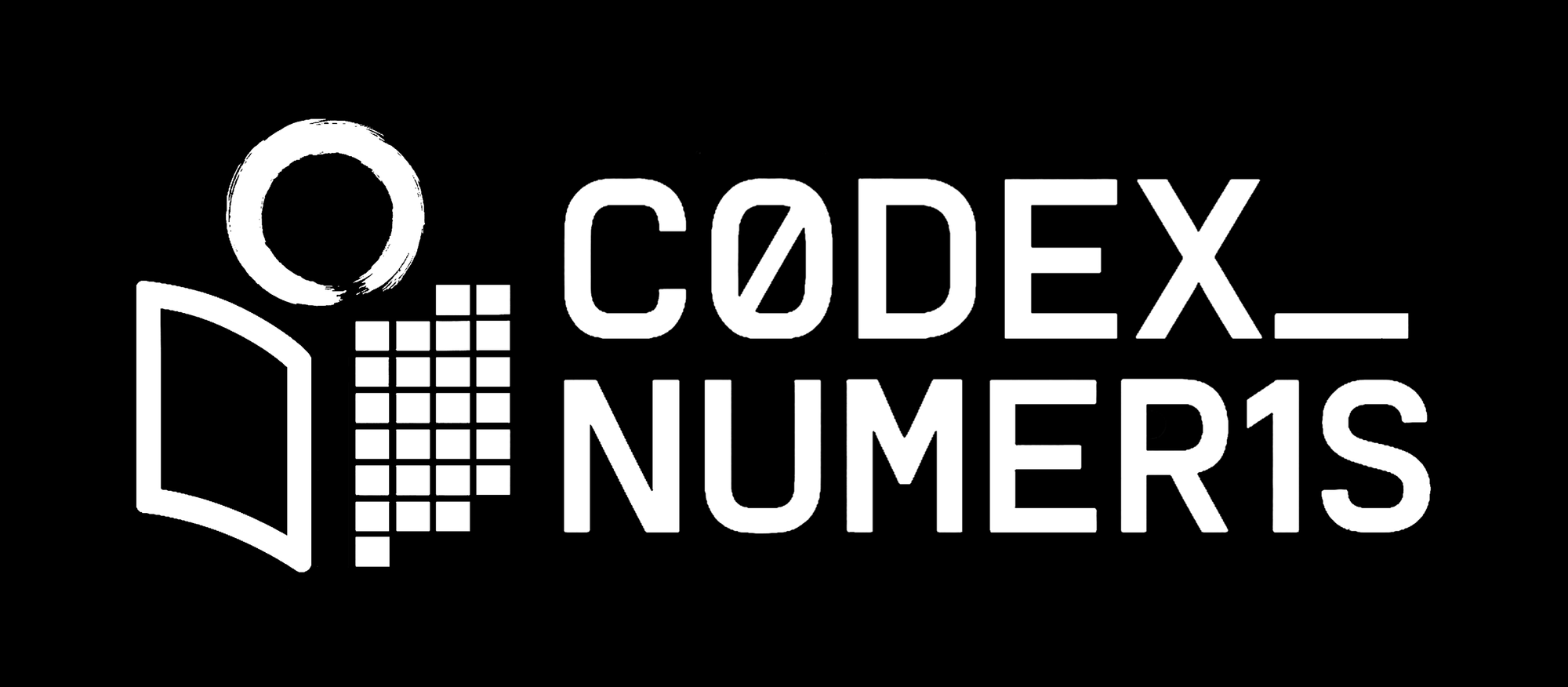18‣ Exploiter le portfolio (1/3) : structure et contenu
Comment structurer un portfolio pour documenter et développer progressivement les compétences ? Une analyse du portfolio par l'IA révèle sa singularité et son efficacité comme dossier d'apprentissage plutôt qu'instrument d'évaluation.
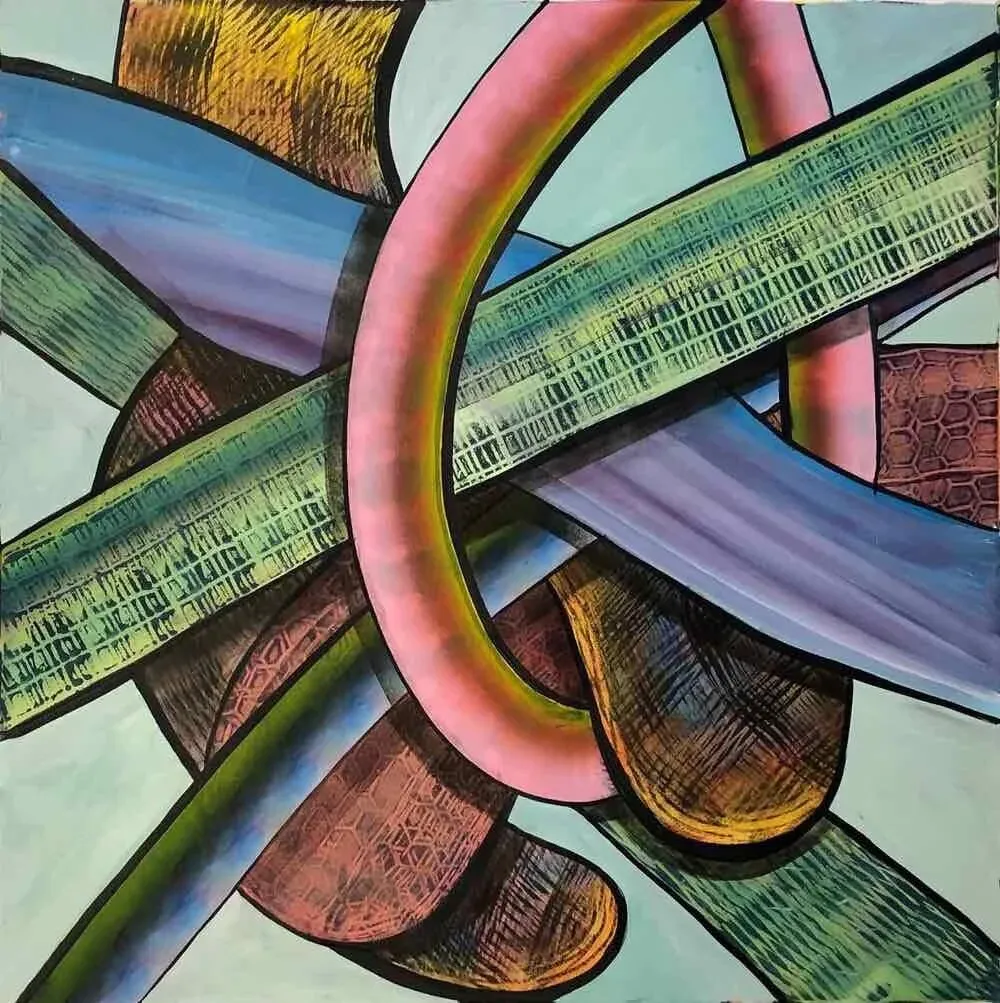
Premier volet d'une série de trois chroniques, cette exploration du portfolio révèle sa structure comme dossier d'apprentissage plutôt qu'instrument d'évaluation. En permettant l'application de différentes stratégies, ce dispositif efficace documente la progression des compétences tout en développant l'autonomie.

Le dossier d'apprentissage
► LE portfolio se définit comme une collection organisée et intégrée de travaux qui permet de documenter le développement des compétences d'un élève sur une période prolongée d'apprentissage. On distingue trois types principaux de portfolios (Martin, 2012). Le portfolio de présentation regroupe les meilleures productions pour démontrer les compétences atteintes. Le portfolio d'évaluation sert à démontrer l'atteinte des compétences à travers une sélection de travaux. Le dossier de progression, aussi appelé portfolio d'apprentissage, permet de suivre le cheminement de l'élève tout en favorisant l'autoévaluation et le développement de la métacognition. C'est ce type de dossier que j'ai choisi dans le cadre de mon cours Écriture et littérature. C’est également la pratique qui est au coeur de l’approche ELLAC.
Ici, les objectifs du portfolio sont multiples. Au départ, ce que je cherchais était surtout d'impliquer activement l'apprenant·e dans son processus d'apprentissage. Mais il s'est avéré que cet outil permet aussi d'observer directement la progression de l'apprenant·e dans le développement des compétences et, par conséquent, d'assurer un suivi individualisé basé sur des preuves tangibles. De plus, le portfolio soutient l'apprentissage par la réflexion et l'autoévaluation de l'élève. Il permet ainsi de développer son autonomie et sa capacité d'autorégulation.
Structure et contenu
Le dossier d'apprentissage, dans le cas qui s'applique ici, à l'automne 2024, est constitué de 14 artefacts (ou exercices) qui permettent de développer et de mesurer à différents moments des compétences essentielles. Pour ce faire, tous les travaux sont évalués selon les mêmes critères durant le trimestre, ce qui permet de mieux voir la progression (structure, rigueur, plausibilité, nuance, français écrit).
L'évaluation des éléments de compétences, quant à elle, prend appui sur la taxonomie SOLO dont je me suis inspiré pour créer les barèmes IDME (insuffisant, en développement, maitrisé ou étendu) pour chaque critère.
Lors d'une première application du portfolio, à l'hiver 2024, j'avais décidé de compiler absolument tous les travaux réalisés par les élèves, qu'ils soient préparatoires (dans une pratique guidée par exemple) ou sommatifs. Ça faisait un total de 21 artefacts. C'est quand même pas mal. Lors d'une deuxième expérimentation, à l'automne suivant, j'ai réduit les travaux à 14. Le tableau suivant présente leur contenu.

La structure du portfolio repose sur l'alignement pédagogique, c'est-à-dire le lien logique et pratique entre les objectifs, les tâches réalisées pendant l'apprentissage et l'évaluation finale de la compétence. Les artefacts du portfolio sont tous des travaux préparatoire à l'évaluation finale (qui est ici une analyse littéraire). Ils servent à appliquer des stratégies de lecture, de rédaction, de révision et de métacognition qui sont enseignées de façon explicite (par modélisation, pratique guidée et pratique autonome). La plupart des exercices sont individuels, mais quelques uns sont réalisé en binôme, afin de favoriser le remue-méninge, la délibération et l'élaboration des idées. Les multiples stratégies exploitées ici sont décrite dans une autre chronique.
Patterns de consolidation
Une fois l'expérimentation terminée, l'intelligence artificielle (Claude Sonnet 3.5, d'Anthropic) a servi à analyser les données anonymisées recueillies durant le trimestre. J'avais 53 élèves répartis dans deux groupes. Cette analyse permet de comprendre plus finement l'apprentissage et l'enseignement et de tirer des conclusions sur le processus.
Claude a notamment relevé divers patterns de consolidation des acquis dans le parcours des apprenant·es. Par exemple, la comparaison entre les artefacts métacognitifs (n° 3 et n° 11) révèle une évolution significative de la réflexion des étudiants sur leur propre apprentissage. Cette progression montre une amélioration notable dans la capacité des étudiants à «structurer» leur réflexion et à s'exprimer avec précision dans un français correct. Cependant, la stabilité relative du critère «nuance» (la richesse et la finesse de la réflexion) laisse entendre que cette dimension reste un défi constant. On peut conclure qu'il faudrait poursuivre le développement de la métacognition dans les autres cours de la séquence pour la consolider.
Autre exemple. Prenons les artefacts liés aux stratégies de lecture en début de trimestre (n° 5) et à la fin (n° 14). L'analyse comparative par Claude offre un aperçu intéressant de l'évolution des compétences en lecture. La progression suggère une amélioration générale dans l'exploitation des stratégies de lecture, mais lorsqu'on observe plus précisément le niveau de maitrise (IDME), on remarque également que cette compétence reste en développement pour beaucoup d'apprenant·es. C'est une bonne leçon à tirer pour l'enseignant·e.
Enfin, dernier exemple, la comparaison entre les artefacts de textes suivis (n° 10 et n° 12) offre un éclairage particulier sur le développement des compétences en rédaction (il s'agit en fait de la compétence du cours). Cette comparaison révèle une amélioration marquée en «structure» et en «plausibilité» : les apprenant·es développent progressivement leur capacité à organiser et à justifier leur pensée dans un processus qui se complexifie avec la pratique.
L'observation des résultats par l'intelligence artificielle révèle trois patterns distincts de consolidation des compétences : une consolidation progressive stable, une consolidation avec plateau et un troisième type de consolidation qui est plus instable. Plusieurs facteurs clés influençant cette consolidation des compétences : la régularité de l'engagement, la qualité de la métacognition et l'utilisation stratégique des jetons (de reprise ou de délai de remise).
Ces observations nous indiquent plusieurs éléments importants pour comprendre la consolidation des apprentissages. Le temps a un rôle majeur dans ce processus. La progression n'est pas linéaire, mais requiert des périodes de consolidation. Les améliorations significatives se produisent souvent après plusieurs semaines de pratique régulière. Comme le souligne Viau (2009), les élèves ont souvent de la difficulté à inscrire leur apprentissage dans le temps. Le portfolio, en documentant régulièrement leurs progrès, leur permet de constater concrètement leur évolution, même quand leur apprentissage n'est pas terminé. Les étudiants qui maintiennent un engagement constant (plus de 90% de complétion) montrent une consolidation plus fiable des compétences. La qualité de la réflexion métacognitive apparaît également comme un prédicteur fiable de la consolidation des apprentissages.
Un des intérêts du portfolio réside dans son approche progressive du développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être. L'analyse des résultats de la cohorte, plus détaillée par l'intelligence artificielle, révèle comment cette progression n'est pas le fruit du hasard et qu'elle repose sur une approche systématique.
Le savoir-faire et le savoir-être aux rayons X de l'IA
D'une part, sur le plan méthodologique, l'apprenant·e développe un savoir-faire en plongeant dans un répertoire de stratégies éprouvées qu'il pourra réinvestir dans ses autres cours (techniques de lecture active, organisation des idées par carte mentale, élaboration de plans structurés). D'autre part, le portfolio cultive des attitudes (ou des savoir-être) indispensables à la réussite : un engagement régulier dans l'effort, une persévérance face aux défis, une implication cognitive soutenue dans les tâches complexes et une capacité à réfléchir sur son propre apprentissage.
Les données recueillies et analysées par l'IA montrent l'acquisition progressive des stratégies. Les artefacts centrés spécifiquement sur l'application des stratégies de lecture révèlent une appropriation graduelle des outils méthodologiques. Bien que modeste, celle-ci se reflète ensuite dans la qualité des analyses produites, là où la «rigueur» se confirme peut à peu. La «plausibilité» et la «nuance», qui sont des dimensions plus subtiles de l'analyse, émergent graduellement à mesure que les apprenant·es gagnent en confiance et en autonomie. Cette évolution témoigne d'une compréhension plus profonde des textes et d'une capacité accrue à développer des interprétations riches. Les observations montrent des progrès significatifs en «nuance» pour les apprenant·es qui maîtrisent bien les stratégies de base. Grâce au portfolio, l'apprentissage se consolide. Mais il faut prendre le temps de vérifier la compréhension de l'apprenant avant de passer à une étape ultérieure ou un exercice plus complexe. C'est un principe important de l'enseignement explicite.
Enfin, l'analyse des parcours par l'IA révèle des progressions particulièrement encourageantes. D'un côté, une évolution remarquable, passant d'un niveau développemental (D ; unistructurel ou multistructurel) à l'excellence (E ; abstrait étendu). D'un autre, la possibilité de redressement après une période difficile : l'apprenant parvient à atteindre un niveau remarquable. Dans tous les cas, les petites victoires renforcent la motivation, favorisent un meilleur engagement et conduisent à un meilleur apprentissage.
Je pense que cette deuxième expérimentation formelle du portfolio – et son analyse détaillée – révèle comment sa préparation son alignement sont importants. En tout cas, je réalise que la structure itérative et le contenu progressif du dossier d'apprentissage en sont peut-être les principales forces.
L'impact de cette approche sur le développement de l'autonomie se manifeste clairement dans mes observations. Ça semble une évidence, mais les données le confirment : le portfolio agit comme une spirale ascendante, comme une boucle récursive, en consolidant les acquis et en favorisant l'autonomie. Les corrélations entre les performances aux artefacts métacognitifs et la progression générale sont particulièrement révélatrices : les apprenant·es qui excellent dans ces moments de réflexion (notes égales ou supérieures à M) montrent une progression plus stable dans leurs autres travaux.
Reste maintenant à voir comment se détaillent la métacognition et l'autonomie et, surtout, quels en sont les facteurs de réussite. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H⇄IA:Ce
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 9 décembre 2024 · Révisé le 20 août 2025
Références
Bélec, C. et Doré, R. (2023). Une recherche collaborative pour renouveler l'enseignement de la littérature au collégial dans une optique de cohérence disciplinaire : l'intérêt d'une approche par compétence de la lecture. [Rapport de recherche PAREA]. Cégep Gérald-Godin et Cégep de Drummondville. [En ligne]
Blum, S. D. (Ed.). (2020). Ungrading: Why Rating Students Undermines Learning (and What to Do Instead). West Virginia University Press.
Conseil supérieur de l'éducation. (2018). Évaluer pour que ça compte vraiment, Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018. Gouvernement du Québec. [En ligne]
Clark, R., & Talbert, R. (2023). Grading for Growth: A Guide to Alternative Grading Practices that Promote Authentic Learning and Student Engagement. Routledge.
Feldman, J. (2023). Grading for Equity: What It Is, Why It Matters, and How It Can Transform Schools and Classrooms (2e éd.). Corwin.
Martin, N. (2012). Conception d'un portfolio pour documenter le développement des compétences de l'élève au collégial [Essai de maîtrise en éducation, Université de Sherbrooke]. [En ligne]
Nilson, L. B. (2014). Specifications Grading: Restoring Rigor, Motivating Students, and Saving Faculty Time. Routledge.
Pasquini, R. (2021). Quand la note devient constructive : Évaluer pour certifier et soutenir les apprentissages. Presses de l’Université Laval.
Viau, R. (2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. ERPI.
À explorer
Pour comprendre l'approche théorique :
- 11‣ Enseigner la lecture littéraire au collégial - L'approche ELLAC qui sous-tend la structure du portfolio : les quatre postures de lecture, les concepts clés et l'évaluation holistique qui remplace les grilles techniques traditionnelles
Pour voir l'application des stratégies :
- 17‣ Enseigner des stratégies - L'enseignement explicite des stratégies cognitives et métacognitives mises en application dans les 14 artefacts du portfolio, du simple au complexe selon une progression structurée
Pour comprendre le système d'évaluation :
- 5‣ Mettre en place une pratique alternative de notation (PAN) - Le système d'évaluation qualitative qui soutient le portfolio : échelle IDME, jetons de reprise et transformation de l'erreur en opportunité d'apprentissage
Pour continuer l'exploration du dispositif :
- 19‣ Exploiter le portfolio (2/3) - facteurs de réussite - Les trois patterns de consolidation identifiés et les facteurs clés qui permettent de construire l'autonomie et la résilience des élèves à travers ce dispositif