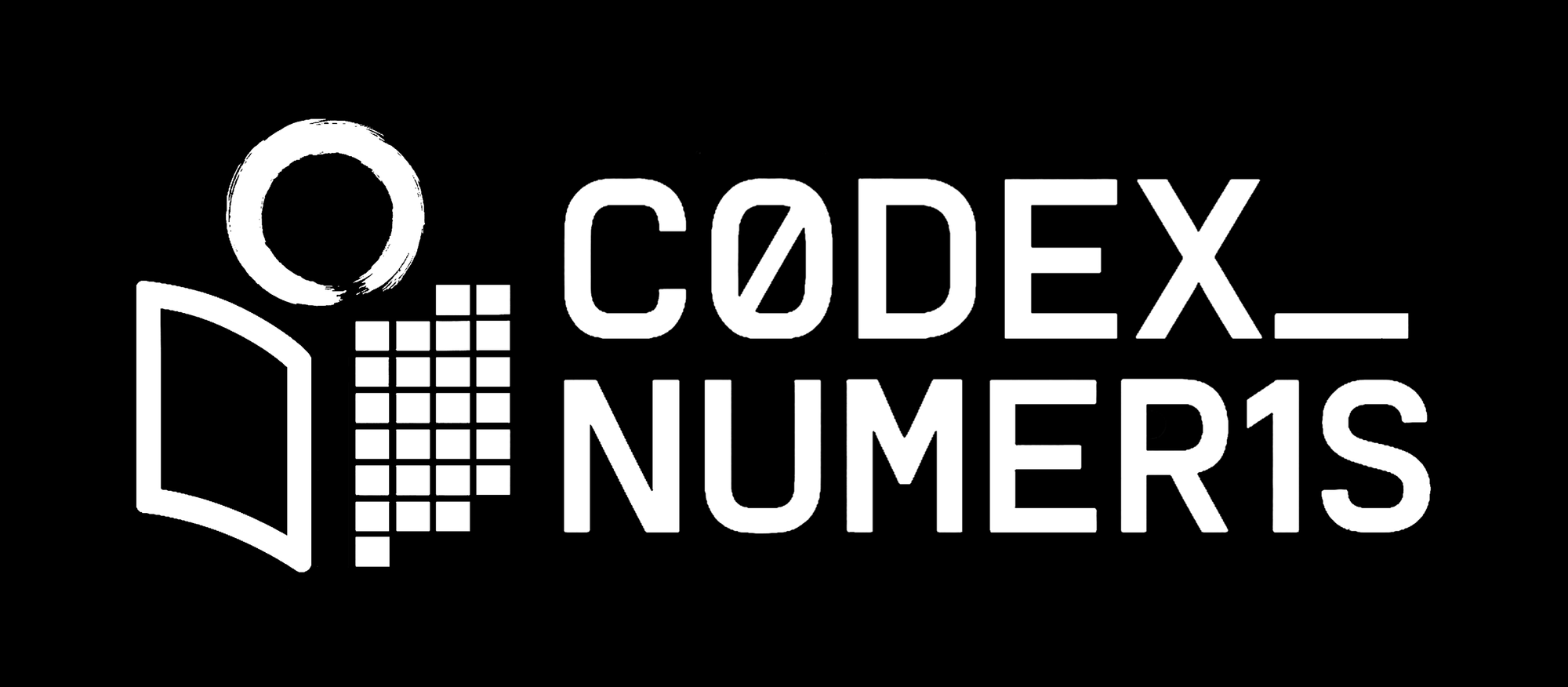Une approche systémique de la classe

L'écosystème-classe comme point de départ
Ce qui est proposé dans la démarche expérimentée ici est de considérer l'apprenant·e comme une personne en interaction avec un système complexe – l'écosystème de la classe. Cette personne a des besoins (sentiments d'autonomie, de compétence et d'appartenance à un groupe) qui, s'ils sont satisfaits, participeront à la motivation nécessaire à l'engagement. C'est à travers l'engagement que se fait l'apprentissage. Sans lui, rien n'est possible.
L'apprentissage est une transformation cognitive et émotionnelle (un travail) qui nécessite de l'énergie et du temps. La démarche pédagogique que nous expérimentons vise à favoriser la motivation et l'engagement par des pratiques alternatives qui répondent aux besoins des apprenant·es. Cette satisfaction se voit à travers différents indices observables en classe qui font en sorte que l'enseignant·e peut ajuster son accompagnement et accroître son impact. Il s'agit, en fait, de pratiquer un enseignement adaptatif à partir de données probantes très simples à recueillir (quand on a de bons outils). L'hypothèse est assez inusitée : peut-on appliquer les principes de la permaculture à cet écosystème humain pour rendre le développement des apprenant·es à la fois viable et durable ?
L’amorce
Un système est un ensemble d'interactions multiples et complexes entre divers éléments. La classe est «écosystème» ouvert, c'est-à-dire un système en relation avec son environnement. L'apprenant·e, qui est lui-même ou elle-même un sous-système complexe, y entre avec son bagage et son capital scolaire et en sort avec un nouveau bagage, de nouvelles connaissances et de nouvelle compétences. L'enseignant·e l'accompagne dans cette transformation en établissant d'abord, par ses pratiques, un cadre sécurisant et motivant. L’amorce sert à lancer le processus.
Expliciter les valeurs et le besoin de relation à bâtir
Au début de chaque trimestre, avant même le premier artefact du portfolio, l'enseignant·e pose les bases de l'écosystème-classe qui va permettre l'apprentissage. Cette amorce repose sur des valeurs qui orientent tous les choix pédagogiques qui suivront : la bienveillance, la réciprocité et l'universalité. L’enseignant.e présente les valeurs qui sous-tendent son enseignement et les partage avec les apprenants. Il explique ensuite comment il compte incarner ces valeurs en classe et dans sa pédagogie, de même que les attentes comportementales qu’il attend des apprenants. La relation entre enseignant.e et apprenants doit être réciproque et en respect de ces valeurs.
Croire en l'éducabilité de chacun·e
Plutôt que de trier les élèves selon leurs performances initiales, l'approche que nous expérimentons ici considère l'apprenant·e comme une personne qui a des besoins fondamentaux (sentiments d'autonomie, de compétence et d'appartenance à un groupe) qui, s'ils sont satisfaits, participeront à la motivation nécessaire à l'engagement. Sans cet engagement, rien n'est possible. La relation entre l'enseignant·e et l'apprenant·e est essentielle. Les deux sont en interaction dans un système complexe – l'écosystème de la classe.
Assumer sa responsabilité d'accompagnement vers l'autodétermination
L'apprentissage est une transformation cognitive et émotionnelle qui nécessite de l'énergie et du temps. Accompagner cette transformation, c'est assumer que notre rôle d'enseignant·e soit celui d'un·e régulateur·rice qui structure l'environnement d'apprentissage pour répondre aux besoins des apprenant·es. C’est une forme de mentorat : l'enseignant·e est à la fois guide et complice de cette transformation. La hiérarchie top-down s'aplatit et les relations sont plus égalitaires dans un tel écosystème.
L'amorce, c'est donc expliciter et incarner ces valeurs et cette vision auprès des élèves : leur faire comprendre que nous allons construire ensemble un environnement d'apprentissage différent, où l'erreur fait partie du processus, où chacun·e peut progresser (enseignant·e et apprenant·es) et où nous observerons constamment ce qui fonctionne pour ajuster notre relation et nous adapter.
1) Observer la dynamique d'engagement
La boucle repose sur une observation continue du comportement de l'élève et de son processus cognitif. À chaque nouveau défi d'apprentissage – chaque artefact du portfolio – la première étape consiste à observer la dynamique d'engagement dans l'écosystème-classe. Qui vient au cours ? Qui fait ses travaux ? Ces questions simples en apparence révèlent en fait des informations cruciales sur la santé du système.
Observer pour comprendre, pas pour juger
Le portfolio devient un outil de documentation précieux quand on pense bien sa structure et son contenu. Ces observations alimentent un tableau de bord simple qui permettra ensuite d'identifier les besoins et d'ajuster les interventions. L'important, c'est de faire bon usage des données collectées : ni trop interpréter, ni ignorer. Cette première étape pose les bases pour comprendre où en sont les apprenant·es avec ce nouvel artefact et quels ajustements seront nécessaires.
Plutôt que de voir l'absentéisme, les travaux non faits ou les retards comme des fautes morales, cette observation nous permet de les comprendre comme des signaux qui nous indiquent quelque chose sur le fonctionnement de l'écosystème. Le monitoring continu de l'apprentissage révèle des dynamiques qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu.
2) Identifier les élèves à risque
Les observations collectées à l'étape précédente permettent maintenant d'identifier précisément les besoins des apprenant·es. Cette identification repose sur trois questions centrales : Quel est le degré d'autonomie des apprenant·es ? Quelles sont les forces et défis liés à la compétence ? Quelle est la nature de leur relation au groupe ?
Les indices A, C et P : une grille de lecture systémique
Le tableau de bord utilise les indices A (assiduité), C (complétion des travaux) et P (performance) pour cartographier les forces et défis de chaque apprenant·e. Cette grille permet d'identifier les patterns qui émergent : quels élèves montrent des signes de désengagement ? Où se situent les blocages récurrents ?
Des outils de diagnostic précis
Une grille descriptive précise aide à diagnostiquer où en sont les élèves dans leur processus cognitif en observant la structure de leurs résultats d'apprentissage. Les critères de Structure, rigueur, plausibilité, nuance et français écrit sont évalués selon 4 barèmes inspirés de la taxonomie SOLO : Incomplet ou insuffisant (préstructurel), en Développement (unistructurel et multistructurel), Maitrisé (Relationnel) et Étendu (Abstrait étendu). Cette grille permet de cerner plus finement les défis rencontrés.
L'identification des patterns et des blocages permet de dépasser l'impression générale pour comprendre précisément ce qui se joue dans l'écosystème. Cette étape de diagnostic est cruciale : elle détermine la qualité des interventions qui suivront. L'objectif n'est pas de catégoriser les élèves, mais de comprendre leurs besoins spécifiques pour mieux les accompagner.
3) Tisser la relation de confiance
Une fois les besoins identifiés, il faut agir sur ce qui permet l'engagement : la relation réciproque. Se saluer à l'entrée et à la sortie de la classe, connaître le nom des élèves (et que les élèves connaissent celui du prof), ces interactions simples créent les bases de la relation de confiance. Dans un écosystème-classe, chaque personne doit se sentir reconnue comme individu avant de pouvoir s'engager dans l'apprentissage.
Reconnaître la personne derrière l'élève
Tisser la relation, c'est aussi reconnaître les défis et les difficultés de chacun·e, mais également leurs forces et leur potentiel. Reconnaître et accepter la neurodiversité comme une richesse de l'écosystème plutôt qu'un problème à gérer.
Le système de jetons : un outil de développement de l'autonomie
Le système de jetons de reprises ou de délai de remise s'inscrit dans cette logique relationnelle où tous les apprenants ont droit à l'erreur (même l'enseignant·e!). Les jetons permettent de consolider les apprentissages après une rétroaction ou de réguler le flux de travail en permettant un délai de 24h dans la remise des travaux.
Cette relation de confiance passe par un encouragement constant et un renforcement positif bienveillant. Il faut célébrer les petites victoires pour nourrir la motivation. Il ne s'agit pas de récompenser la performance, mais de valoriser l'engagement dans la démarche d'apprentissage.
Cette étape crée les conditions nécessaires pour que l'accompagnement de l'étape suivante soit efficace. Sans cette relation de confiance, les meilleures interventions pédagogiques restent inopérantes.
4) Accompagner en utilisant des moyens efficaces
L'accompagnement se déploie en deux temps : avant l'évaluation par l'enseignement explicite, et après l’évaluation par la réponse différenciée aux besoins identifiés.
L'enseignement explicite : créer un cadre sécurisant
L'enseignement explicite structure l'apprentissage en trois phases progressives : modélisation, pratique guidée, pratique autonome. L'enseignant·e montre d'abord comment procéder, puis guide la pratique collective, avant de laisser les élèves expérimenter de façon autonome. Cette transparence des processus participe au sentiment d'efficacité personnelle et au sentiment de compétence des apprenant·es.
Le modèle de Réponse à l'Intervention : ajuster selon les besoins
Après l'évaluation, le modèle RàI organise l'accompagnement selon trois niveaux d'intervention :
- Niveau 1 (100% des élèves) : pratiques alternatives de notation pour tous et rétroactions différenciées (grâce à un système automatisé et intelligent)
- Niveau 2 (15% des élèves) : suivi en classe ciblé sur la similitude des besoins
- Niveau 3 (5% des élèves) : suivi hors classe avec équipe multidisciplinaire pour les besoins individuels
L'objectif est d'accompagner chaque apprenant·e dans son développement, en adaptant l'intensité du soutien selon ses besoins spécifiques, tout en gardant des attentes élevées envers tout le monde.
Les émergences
Autonomisation → Motivation → Engagement
Les émergences de l'écosystème sont des résultats que l'on n'avait pas explicitement programmés, mais qui se manifestent de façon observable en classe. Elles témoignent de la vitalité du système et de sa capacité d'auto-organisation.
L'accroissement des sentiments d'autonomie, de compétence et d'appartenance
À travers les cycles d'observation, d'identification, de relation et d'accompagnement, les apprenant·es gagnent progressivement en autonomie. Ils et elles développent une confiance multiple : confiance en l'enseignant·e, confiance en eux-mêmes, confiance dans le processus. Cette sécurité relationnelle et méthodologique leur permet d'avoir moins peur de l'erreur, de prendre des risques intellectuels, d'explorer la pensée divergente sans crainte d'être pénalisé.
Une progression non-linéaire
Cette confiance accroît leur motivation, qui fournit à son tour l'énergie nécessaire à l'engagement dans l'apprentissage. Mais la progression n'est pas linéaire : elle se fait de retours, de reculs, d'avancées. L'élève réinvestit ses acquis – cognitifs, émotionnels et relationnels – dans un nouveau cycle de travail avec l'artefact suivant du portfolio.
La récursivité du système
La boucle devient récursive : chaque cycle, malgré ses fluctuations, renforce globalement le suivant. L'apprentissage devient pérenne et profond parce qu'il est incarné dans une expérience humaine complexe. L'écosystème-classe évolue ainsi vers plus de résilience et d'efficacité, créant les conditions de son propre développement.
Cette boucle d'apprentissage ne fonctionne pas en vase clos. L'écosystème-classe s'inscrit dans un système plus large en constante évolution. L'enjeu est de développer chez les apprenant·es des compétences durables et transférables, tout en cultivant leur capacité d'adaptation et leur résilience face aux défis du XXIe siècle.
La récursivité de l'écosystème permet non seulement l'apprentissage des élèves, mais aussi l'évolution continue de la pratique enseignante. C'est elle qui transforme une simple méthode pédagogique en système vivant et adaptatif.
Tout ça n'est pas si nouveau, mais c'est complexe. Ça demande des ajustements. Or, réorienter ou changer sa pratique d'enseignement, c'est remettre en question ce que l'on fait et pourquoi on le fait. C'est voir (parfois intuitivement) que la pratique ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle devrait être. Ça demande beaucoup d'humilité : celle de l'apprenant·e.
Ici, l'enseignant·e est un·e apprenant·e et Codex Numeris une communauté de support au développement professionnel.
Bienvenue dans l'expérimentation !
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 27 juillet 2025 · Révisé le 31 août 2025