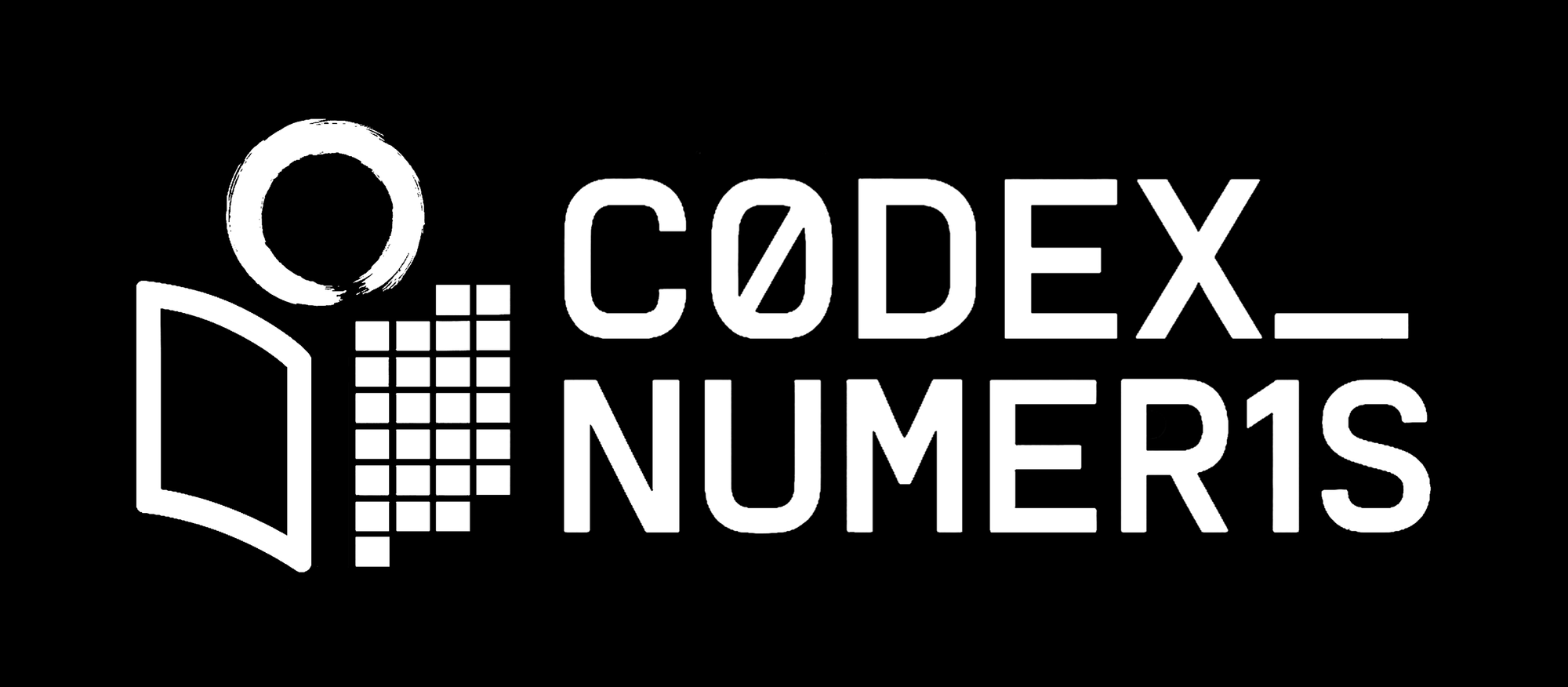9‣ Adapter le modèle RàI au collégial
Comment adapter le modèle de la Réponse à l'intervention au contexte collégial pour maximiser la motivation et l'engagement des élèves ?

Le cours «Écriture et littérature» est un «cours défi» pour l'apprenant·e. Face à cette réalité où une majorité des élèves nécessite un soutien accru, une adaptation du modèle de la «Réponse à l'intervention» (RàI) inspire trois niveaux d'intervention : enseignement universel, intervention intensive regroupée et intervention intensive spécialisée.

Le modèle RàI traditionnel
► C'EST bien de diagnostiquer les besoins de l'apprenant·e le plus tôt possible, mais c'est encore mieux d’y répondre adéquatement. Comment organiser et structurer ces interventions ? Le modèle de la Réponse à l'intervention (RàI) est une approche systématique visant à identifier et soutenir les élèves en difficulté. Au Québec, son application est bien documentée au primaire et secondaire, mais très peu au collégial. Je me suis surtout servi, ici, du Référentiel d'intervention en écriture, produit par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en 2017, pour orienter mes expérimentations. Je ne prétends pas du tout avoir des compétences en orthopédagogie, mais ce modèle est très inspirant pour améliorer mes compétences actuelles.
L'intérêt d'un modèle RàI adapté à la réalité du niveau collégial réside dans la même approche systématique et préventive : il met l'accent sur «la prévention qui se traduit par la mise en place d'un enseignement efficace et de stratégies gagnantes pour tous les élèves.» (Référentiel, p. 12). À défaut de travailler avec une équipe, j'ai tenté du mieux que j'ai pu de m'approprier ce modèle et de l'appliquer dans ma classe. J'ai un peu tâtonné au début, mais au fil des sessions j'y trouve mon compte. Et les élèves aussi.
Comme le précise le Référentiel, certains élèves «ont besoin de plus d'enseignement que celui offert au niveau 1 pour progresser de façon satisfaisante.» (MEES, 2012, p. 14). C'est pour répondre à ces besoins que la RàI propose trois niveaux d'intervention progressifs : d'abord, un enseignement de haute qualité devrait généralement répondre aux besoins de 80% des élèves. Des interventions supplémentaires plus ciblées, en petits groupes, devraient ensuite soutenir efficacement environ 15% des apprenant·es. Enfin, ce sont des interventions supplémentaires intensives de troisième niveau, individualisées, qui devraient répondre aux besoins des 5% restants. Ce que l'on observe ici, c'est la réponse de l'élève à l'intervention de l'enseignant·e. Des mesures régulières permettent de prendre des décisions sur des données probantes pour orienter les interventions suivantes.
Les interventions reposent sur l'intensification des mesures, mais toujours à partir des niveaux précédents préalables. Elles ne signifient pas un changement radical d'approche, mais une continuité. Celle-ci permet de maintenir la cohérence des apprentissages tout en augmentant le niveau de soutien.
Une adaptation redistribuée
La répartition traditionnelle 80-15-5 ne correspond pas tout à fait à la réalité d'un «cours défi» comme «Écriture et littérature» où une majorité d'élèves a besoin d'une forme d'intensification de l'accompagnement. Face à cette réalité, j'ai développé une adaptation (peut-être pas très orthodoxe, je l’avoue) du modèle RàI qui maintient les trois niveaux, mais en redéfinissant un peu leur distribution et leur intensité. Les phases de l'enseignement explicite jouent sur plusieurs niveaux.
Niveau 1 - Enseignement universel avec accompagnement intégré
- Tous les élèves font face aux défis inhérents à ce cours exigeant.
- Je fais des vérifications fréquentes et systématiques de la compréhension des apprenant·es par le biais d'un enseignement explicite, d'un questionnement constant et d'une évaluation formative continue. J'intègre naturellement un accompagnement personnalisé à travers la pratique guidée (en groupe, puis individuelle).
- J'offre des opportunités de reprise et de rattrapage à tout le monde avec un système de jetons de reprise.
Un exemple, celui de Marie-Ève. Il s'agit d'une apprenante assidue, qui complète tous ses travaux. Elle est active en classe et je sollicite parfois son attention par des questionnements sur ce que nous venons de voir. Elle a un bon esprit de synthèse et un vocabulaire juste. Elle fait de bonnes déductions et je sens que ses mini-conclusions seront efficaces. Je me sers de ses réponses adéquates pour renforcer son comportement, mais aussi pour modéliser son effort et rendre visible son raisonnement aux yeux des autres élèves. Marie-Ève a utilisé un jeton pour reprendre un travail après avoir reçu ma rétroaction écrite. Elle a passé du niveau D au niveau M avec une certaine aisance. Elle fait partie de la majorité des apprenant·es pour qui le niveau 1 est suffisant pour réussir.
Niveau 2 - Intervention intensive personnalisée
- Ce niveau s'adresse aux élèves qui font face temporairement ou durablement à des défis. Ces apprenant·es ont besoin d'un accompagnement supplémentaire.
- Cet accompagnement implique une approche proactive de la part de l'enseignant : les apprenant·es apprennent à apprendre, comme dirait Edgar Morin. Ils et elles ne savent pas toujours s'autoréguler ni demander de l'aide, alors je dois prendre les devants et modéliser l'identification des difficultés et des besoins. C'est une façon de développer leur métacognition et leur autonomie. Les évaluations critériées me permettent de voir où sont les acquis à consolider et les faiblesses à renforcer et j'agis en conséquence.
- Je propose un accompagnement de niveau 2 qui se fait en classe. Je regroupe parfois les élèves qui ont des besoins similaires pour refaire un enseignement, mais c'est quelque chose d'assez difficile au cégep parce que les élèves ne se connaissent pas entre eux et ne sont pas toujours confortables dans ces situations. Le niveau 2 d'intervention est celui qui me demande le plus d'ajustements par rapport à la pratique traditionnelle de la RàI. Il est plus facile pour moi de faire cet accompagnement hors classe. Une astuce que j'ai découverte est celle d'offrir ma période de disponibilité tout de suite après le cours et de demeurer en classe avec les apprenant·es qui en ont besoin.
Voyons l'exemple de Samuel. Son parcours illustre l'impact d'une intervention de niveau 2 plus ciblée. Après un début difficile marqué par des absences et deux artefacts non complétés, il a fallu une prise en charge à la 5e semaine pour permettre un revirement significatif. Sur le plan de la littératie, Samuel a de la difficulté avec les critères de rigueur et de français écrit. Samuel travaille souvent en équipe avec Marc-Antoine, qui est dans le même programme que lui. Les deux copains ont une motivation de performance qui est fragile et partagent les mêmes difficultés à approfondir leurs observations sur les textes qu'ils analysent. Les deux sont aussi des «chasseurs de figures de style». C'est à peu près tout ce qu'ils cherchent et leur interprétation se limite à paraphraser ce que l'autrice dit déjà.
Je suis allé les voir en classe et nous avons passé du temps tous les trois, après le cours, à reprendre mon enseignement et leur apprentissage autrement. Pour y arriver, nous avons comparé le texte littéraire original («Tu fais souffrir la femme qui t'a mis au monde») et une formulation neutre qui ne comprend pas de procédé («Tu fais du mal à ta mère»). J'ai demandé : quels sont les mots qui font le plus de différence entre les deux formulations ? «Le verbe souffrir?» dit l'un. Oui, c'est bien. Quelle est la différence de sens entre la périphrase «la femme qui t'a mis au monde» et cette formulation plus neutre qu'est juste «ta mère» ? «On dirait qu'il fait un reproche!» Oui... «Il joue sur la culpabilité ?» demande l'autre. Très bien ! Tu viens d'approfondir ta lecture ! Les deux garçons comprennent l'apport de chaque procédé isolé. Voyons maintenant comment les deux procédés participent à cette mise en accusation implicite... Samuel me regarde avec un éclat dans les yeux. «C'est comme quand on pèse un chat», dit Samuel. On se pèse avec et sans le chat, puis on fait la différence de poids!» Exact! On vient de débloquer quelque chose, pas vrai ?
Niveau 3 - Intervention très intensive ou spécialisée
- Ce niveau concerne les apprenants qui nécessitent un soutien substantiel et constant. Parfois, l'accompagnement de l'enseignant·e n'est pas suffisant ou les besoins sont trop précis pour ses compétences. Il implique une aide spécialisée : l'enseignant·e quand il s'agit d'un défi lié à la discipline, une aide du Centre d'aide en français quand c'est un défi linguistique, un·e intervenant·e des Services adaptés quand il s'agit de difficultés d'apprentissage liées à une condition particulière, un coup de pouce de l'Aide pédagogique individuelle quand il s'agit de conditions externes difficiles.
- Ce soutien se déroule principalement hors classe et sur rendez-vous. Il permet un accompagnement plus approfondi et hautement individualisé.
Sofia illustre la pertinence d'une intervention intensive et coordonnée. Étudiante internationale confrontée à des défis linguistiques et d'adaptation culturelle, elle maintient une assiduité remarquable (100%) et complète tous ses artefacts, mais ses performances sont fluctuantes. Elle se sent décalée par rapport aux autres élèves. De mon côté, je vois qu'elle a des difficultés à être autonome. Je crois qu'elle est anxieuse et qu'elle fait un peu d'évitement. La collaboration entre différents services (aide pédagogique, travailleuse sociale) et des rencontres hebdomadaires à mon bureau ont permis de stabiliser sa situation. Son cas démontre l'importance d'une approche holistique dans l'intervention de niveau 3, particulièrement pour les élèves cumulant des défis de capital scolaire et culturel et des difficultés d'intégration dans un nouvel environnement.
Le cas de Léa souligne l'importance d'une intervention de niveau 3 face à des difficultés complexes. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour de la remédiation, mais les résultats sont lents à consolider. J'ai remarqué en rencontres individuelles à mon bureau que lorsque Léa lit un texte à voie haute, il arrive souvent qu'elle n'utilise pas les bons mots. Ce qu'elle lit n'est pas ce qui est écrit. Par conséquent, elle a du mal à comprendre les textes et les analyser. Je sais que Léa est suivie par une éducatrice spécialisée aux Services adaptés. Peut-être qu'il y aurait matière à obtenir un diagnostic en orthopédagogie ? Un petit coup de fil m'apprend qu'elle est inscrite au CAF et que son tuteur a fait le même constat que moi. Des démarches sont déjà en cours. Léa devrait y arriver, nous sommes plusieurs sur le coup.
Perspectives et limites
Comme le souligne le Référentiel d’intervention en écriture, les interventions doivent être suffisamment différenciées pour assurer la progression des élèves. Mais la plus grande difficulté de l’application du modèle RàI au cégep demeure la gestion du temps et de l’espace. Honnêtement, je ne suffis pas aux interventions. Pour y parvenir, on peut peut-être envisager (ou rêver à) un réaménagement des ressources actuelles et un travail d’équipe plus concerté.
Le défi principal est l'organisation des interventions intensives dans un cadre horaire peu flexible. On pourrait imaginer, par exemple, que cette adaptation pourrait se concrétiser à travers un Centre d'aide en littératie et en français écrit (CALFÉ), une structure permettant d'opérationnaliser les différents niveaux d'intervention. Les interventions de niveau 1 resteraient en classe, celles de niveau 2 prendraient la forme d'ateliers au CALFÉ, et les interventions de niveau 3 se dérouleraient dans un cadre individualisé. Cette structure faciliterait la coordination entre intervenants tout en assurant un suivi systématique des progrès. Cette géométrie variable crée une synergie où les intervenant·es peuvent soutenir les apprenant·es en fonction de leurs besoins sans y laisser leur peau.
Mais au-delà de ces défis, mon exploration très basique du modèle RàI en contexte collégial montre qu'il est possible de structurer notre accompagnement pour mieux soutenir la réussite. J'ai demandé un coup de pouce de ma collègue orthopédagogue. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide des experts.
Une difficulté, c’est de maintenir des attentes élevées tout en demeurant réaliste sur les résultats escomptés. Malgré tous ses efforts, l’enseignant·e est parfois impuissant·e devant une combinaison de facteurs défavorables. On revient souvent à la motivation et l'engagement de l'apprenant·e. Mais l'expérience me rappelle encore une fois que la qualité de la relation pédagogique reste au cœur de l'apprentissage. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 18 novembre 2024 · Révisé le 29 août 2025
Références
Groupe de travail sur les cours défis (2023), Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep, Rapport du groupe de travail mis en place dans le cadre de la mesure 3.5 du Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) 2021-2026 [En ligne]
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (2012), Référentiel d’intervention en écriture [En ligne]
À explorer
Pour maîtriser les outils de dépistage :
- 1‣ Monitorer l'apprentissage - Le système de monitorage "artisanal" compilant assiduité, complétion et performance qui constitue la base du dépistage précoce nécessaire avant toute intervention RàI
Pour affiner le diagnostic des difficultés :
- 7‣ Dépister avec la taxonomie SOLO - Comment identifier précisément les blocages d'apprentissage (unistructurel, multistructurel, synthèse) pour orienter les interventions pédagogiques ciblées selon les niveaux RàI
Pour appliquer l'enseignement universel :
- 34‣ Appliquer le modèle de la Réponse à l'intervention (niveau 1) - Les sept actions pédagogiques concrètes (enseignement explicite, différenciation, dépistage précoce) qui constituent la base de l'intervention universelle adaptée aux cours-défis
Pour intégrer dans une démarche systémique :
- 25‣ Adapter sa pédagogie - Comment l'adaptation du modèle RàI s'articule avec les six autres pivots du projet pilote pour créer une transformation pédagogique cohérente et basée sur les données probantes