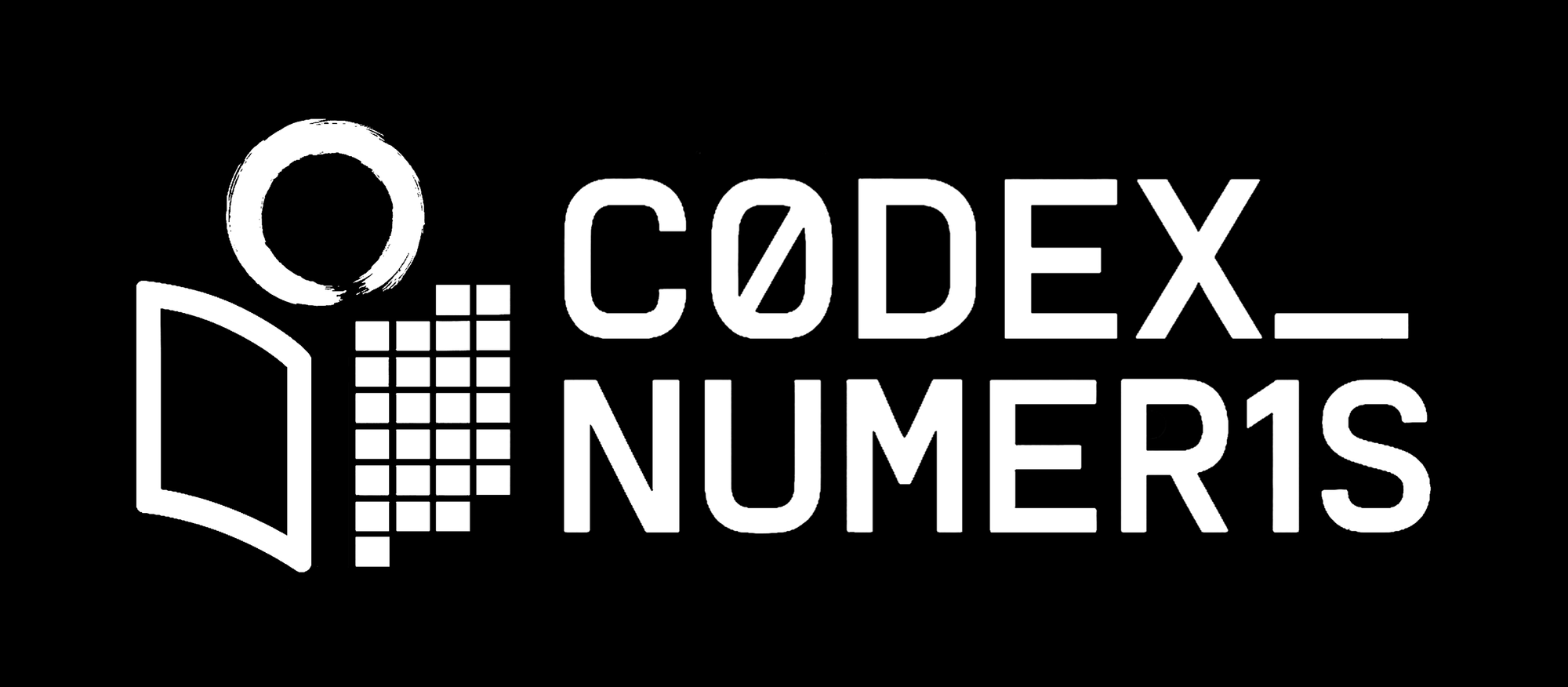4‣ Centrer l'apprentissage sur le processus
Comment centrer l'enseignement sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le produit final ?

L'Épreuve uniforme de français (EUF), instituée en 1996, impose dans les cours de littérature au collégial un produit final manuscrit, créé en quelques heures, qui est déconnecté de la réalité numérique contemporaine. L'intelligence artificielle générative bouleverse cette pratique en déclassant la rédaction des compétences de haut niveau vers les habiletés de base. Comment centrer l'enseignement sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le produit final ? Explorons quelques pistes pour s'adapter à cette disruption.

La portée de l’Épreuve uniforme
► L'ÉPREUVE uniforme de français (EUF) reste centrale dans l'enseignement de la littérature au collégial. Elle exige une dissertation critique manuscrite de 900 mots en 4h30, sans notes ni appareils électroniques. Sa réussite conditionne l'obtention du DEC depuis 1998. Ce format, issu d'une époque pré-Google, soulève aujourd'hui des questions sur son authenticité : qui écrit encore à la main, sans documentation, à partir d'une question inconnue, pendant quatre heures ? C'est l'idée même de «test» qui est questionnable ici...
Je crois que l'arrivée disruptive de l'IA dans le paysage éducatif appelle à une refonte majeure de nos méthodes d'enseignement et d'évaluation pour les rendre plus cohérentes avec la réalité d’aujourd’hui. Mais le changement de paradigme est… considérable.
L'importance des compétences de haut niveau
À la fin des années quarante, Benjamin Bloom et des dizaines de collègues ont créé une échelle taxonomique visant à classer les différentes habiletés cognitives. Cette taxonomie, révisée par Anderson et Krathwohl au tournant du siècle, fait encore autorité aujourd’hui. Elle est composée de 6 niveaux hiérarchiques, chacun présentant des opérations intellectuelles typiques.

Le développement de la littératie (la capacité à lire, comprendre, interpréter, évaluer, critiquer puis écrire des textes) peut exiger des habiletés de haut niveau. Elles impliquent une manipulation complexe des idées et une réflexion approfondie sur le processus d'apprentissage lui-même. On associe la pensée complexe à la rédaction, parce que les processus cognitifs sollicités sont de haut niveau.
Ce qu'on appelle des «compétences de haut niveau» (HOTS – High Order Thinking Skills) fait référence aux capacités d'analyse, d'évaluation, de création et de réflexion critique qui vont au-delà de la simple mémorisation ou l'application de connaissances. Les HOTS font référence aux processus cognitifs complexes identifiés dans les niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom révisée. L'utilisation de l'IA pour la tâche de la «rédaction» (d'analyses ou de dissertations) remet en question le niveau de complexité cognitive de cette habileté. Il la renvoie certainement plus loin dans les compétences de bas niveau (LOTS – Low Order Thinking Skills).
Comment pouvons-nous nous concentrer sur le développement des compétences de haut niveau ? La réponse pourrait se trouver dans une attention accrue au processus cognitif lui-même plutôt qu'au produit final. Ce n'est peut-être pas la destination qu'il faut regarder, mais le chemin emprunté pour s'y rendre. Et c'est ici que le rôle de «guide» de l'enseignant·e s'avère important dans l'apprentissage.
L'accent sur le processus d'apprentissage
En mettant l'accent sur des compétences de haut niveau, on peut développer des habiletés cognitives qui sont non seulement utiles dans la vie moderne, mais qui sont aussi observables et mesurables dans un parcours d’apprentissage.
Les apprenant·es appliquent différentes stratégies de lecture, utilisent des techniques d'annotation, exploitent des méthodes d'organisation des idées. Ils développent leur argumentation de manière méthodique et démontrent leur compréhension approfondie dans une rédaction assez fine. Chaque étape du processus permet de laisser des traces que l'enseignant·e peut interpréter pour évaluer l'apprentissage et intervenir.

Une approche basée sur le développement de la littératie – plutôt que la rédaction d'un texte – peut potentiellement accroitre la valeur de l’apprentissage en misant sur des compétences de haut niveau. Ceci peut aussi accroître la pertinence perçue des cours de littérature aux yeux des étudiants, en particulier ceux qui ne se destinent pas à des carrières littéraires (c’est-à-dire à peu près tout le monde). Derrière le développement de la littératie, on trouve l'autonomie dans une société moderne, le sentiment de compétence et le sentiment d'appartenance à un groupe. Passer de la littérature à la littératie révèle comment la lecture et l'écriture ne sont pas une fin en soit, mais un moyen de se développer.
Ce changement de cap permet aux élèves d'exercer progressivement leurs compétences en impliquant différentes habiletés cognitives à travers des stratégies enseignées de façon explicite. De l'interprétation des idées à leur structuration en passant par leur développement et leur expression, la pratique guidée permet à l'enseignant·e de voir comment l'étudiant construit sa compréhension et son interprétation. L'enseignement, l'accompagnement et l'évaluation formative de ces phases renforcent l’alignement constructif du processus. Il ancre l'apprentissage encore plus profondément et accroit sa pérennité.
L’évaluation axée sur le processus offre également des opportunités d'intervention pédagogique ciblée sur le cheminement personnel de l'étudiant plutôt que sur un résultat ponctuel en fin de parcours. De plus, l'accent sur le processus encourage davantage la métacognition en rendant les étudiants plus conscients de leurs propres processus de pensée et d'apprentissage. Elle pourrait participer à les rendre plus compétents et plus autonomes.
Cette machine est-elle faite pour tricher ?
Étonnamment, la prochaine étape dans cette évolution pédagogique pourrait bien être l'intégration de l'IA comme partenaire de rédaction. On peut imaginer que les étudiant·es fourniraient leur plan détaillé à un système d'IA qui se chargerait ensuite de la rédaction de l'analyse littéraire. Comment assurer le développement de la littératie si on délègue la rédaction à une machine ?
Il s’agirait d’en faire une autre étape du processus où la réflexion se poursuit avec la même rigueur. Les étudiants pourraient évaluer la fidélité du texte produit par l'IA par rapport à leur plan initial. Il leur faudrait identifier les écarts entre leurs intentions et l'interprétation de l'IA, analyser ses choix stylistiques et l'intégration des preuves, juger de leur pertinence et éventuellement améliorer itérativement leur travail en fonction des résultats obtenus.
A priori, les élèves ne cherchent pas à tricher. Ils veulent sincèrement développer leur autonomie et leur sentiment de compétence. C'est tout à fait légitime. Ils veulent apprendre. Et l'enseignant est là dans la classe, présent, informé sur leur parcours, à l'écoute et disponible. Pourquoi demander de l'aide à une IA quand mon prof est là, à côté de moi, pour répondre à mes questions et me guider dans ma pratique ?
Il me semble que la tricherie devient moins tentante… Pourquoi jouer à la police avec les élèves quand une autre solution créative est possible ?
L'appropriation de l'IA dans notre pédagogie pourrait rendre notre enseignement plus relationnel, peut-être même plus bienveillant. L'IA nous contraint à nous concentrer davantage sur l'accompagnement personnalisé de nos étudiants dans leur processus d'apprentissage.
Cette approche s'inscrit dans la vision de Bowen et Watson qui rappellent que «l'objectif n'est pas de faire réfléchir l'IA à votre place, mais d'avoir un dialogue qui vous aide à réfléchir.» Il s'agit donc de faire de l'IA un outil au service de la pensée critique plutôt qu'un substitut à celle-ci.
Défis et considérations éthiques
Il n'y a pas de doute que l'intelligence artificielle générative nous bouscule. Elle nous oblige à repenser nos pratiques pédagogiques. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et si notre intention est de préparer nos étudiants aux défis du 21e siècle, c'est peut-être une chance que nous avons. L'école – nos cours de littérature – peut revenir dans la réalité du vrai monde plutôt que de créer des situations d'écriture qui ne s'appliquent jamais à la vraie vie.
Que l'IA prenne en charge la rédaction ou non, notre enseignement peut tout à fait se concentrer sur le développement des compétences de haut niveau en littératie. Nous pouvons peut-être mieux préparer nos étudiants à un monde où la «collaboration» humain-machine sera de plus en plus courante. Comme le soulignent encore Bowen et Watson dans Teaching with AI, «Ceux qui peuvent collaborer et réfléchir avec l'IA remplaceront progressivement ceux qui ne le peuvent pas.» C'est une compétence qui pourrait s'avérer précieuse dans leur future vie professionnelle.
Toute exploration n’est pas sans incertitudes. Et il va sans dire que les découvertes se font parfois « par accident ». Le développement d’une pratique est jalonné de questionnements, d'expérimentations, d'imperfections, de doutes, parfois de ratés, mais surtout d'ajustements constants. Peut-être que ce qui fait un·e bon·ne enseignant·e, c'est d'abord le fait d'être un·e bon·ne apprenant·e. Apprendre, réfléchir, intégrer, ce sont des processus. Pas des techniques. Il faut du temps. _ ◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 27 octobre 2024 · Révisé le 14 août 2025
Références
BIGGS, John B. & Kevin F. Collis (1982), Evaluating the Quality of Learning ; The SOLO Taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome). Elsevier Inc.
Fortier, D. (2012). L'épreuve uniforme de français et «Correspondance». Correspondance, 17(2). [En ligne]
Gouvernement du Québec, Épreuve uniforme de français [En ligne] Consulté le 13 octobre 2024.
À explorer
Pour découvrir les stratégies concrètes :
- 17‣ Enseigner des stratégies - L'enseignement explicite des stratégies cognitives : de la lecture active à la carte mentale, jusqu'au plan structuré qui libère la charge cognitive
Pour comprendre l'approche pédagogique :
- 27‣ Pratiquer l'enseignement explicite - Comment rendre visibles les processus cognitifs par le modelage, la pratique guidée et l'autonomie progressive
Pour voir l'analyse des données :
- 10‣ Identifier des patterns et des blocages dans l'apprentissage - La validation empirique : les corrélations entre stratégies de lecture, carte mentale et qualité du plan
Pour approfondir la théorie :
- 16‣ Équilibrer la charge cognitive - Le séquençage méthodologique qui libère la mémoire de travail et améliore la qualité linguistique