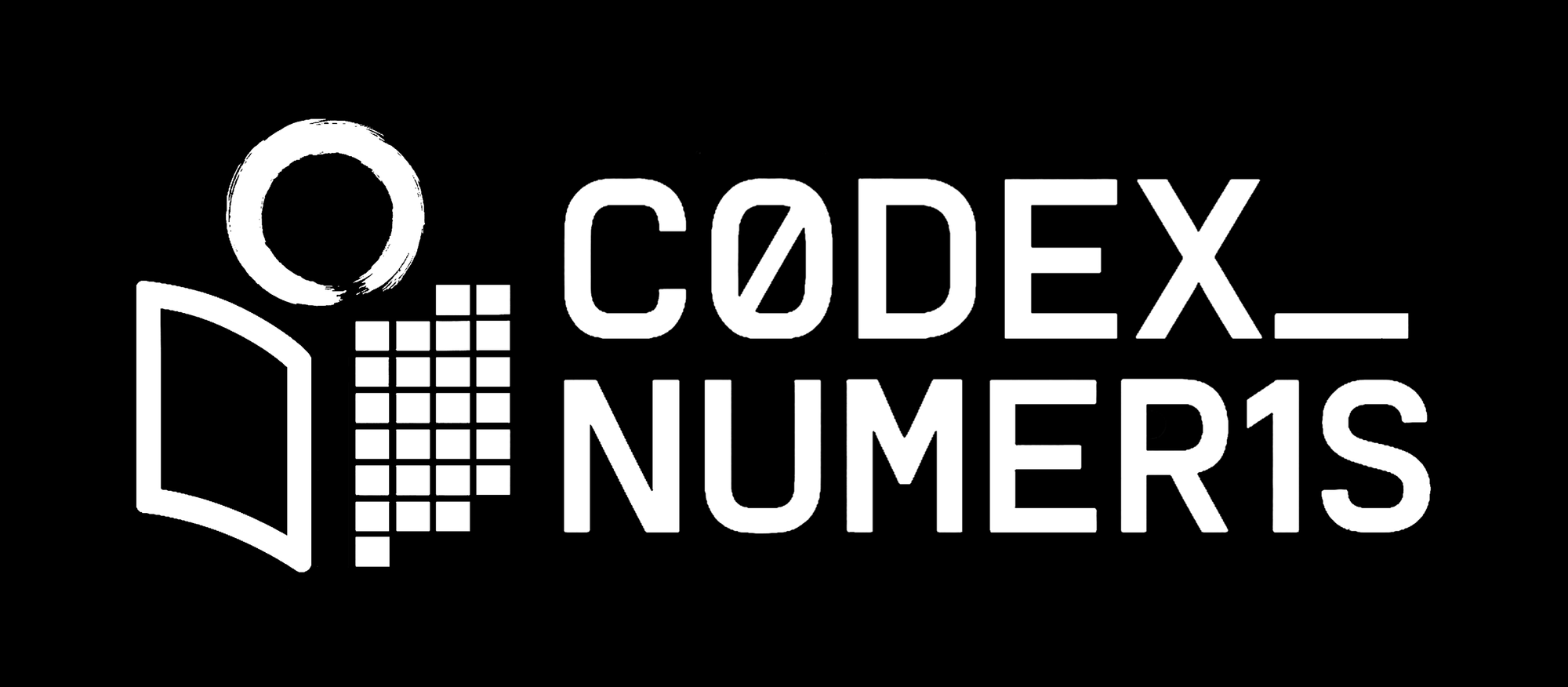50‣ Des grilles et de leurs limites
Comment une grille d’évaluation peut-elle se révéler un socle pédagogique fondamental ?

Une grille d’évaluation est à la fois captivante et bien simple. Les éléments qu’on y juge prioritaires, ceux considérés comme secondaires, les justifications qui les sous-tendent, ainsi que les interconnexions entre les divers axes qui constituent sa logique interne, révèlent des aspects profonds de notre pédagogie, de nos méthodes, voire de notre sens de la justice et de l’équité. Comment une simple grille d’évaluation peut-elle se révéler un socle pédagogique aussi fondamental ?

La grille comme une liste
► QUAND j'ai commencé à enseigner, je n'avais absolument aucune idée de comment on montait une grille d'évaluation. J'ai pris la grille de mes collègues et je l'ai appliquée. Il y avait une liste d'items à gauche, une liste de points à additionner à droite. Un peu comme une facture. Avec le total en bas de la colonne.
C’était une grille structurelle. Au sens dimensionnel, c’était une grille plate comme un coup de crayon. Il y avait des points pour l’introduction, la conclusion. Des points pour le développement : idées principales et secondaires, transition. Les critères étaient essentiellement : clarté, pertinence, qualité de l’argumentation. C’était assez simple. Juste assez simple pour être compliqué en fait. Parce que c’est quoi, au juste, la pertinence ? Qu’est-ce qui fait la qualité d’une argumentation ? Ça, c’était implicite et pas du tout évident.
Je n’exagère même pas : pendant vingt ans j’ai cherché à comprendre ces critères, à les préciser, à les substituer par d’autres, à les décrire un peu plus, un peu moins, à les regrouper, à les séparer. J’ai fait des colonnes, des rangées. J’ai essayé d’avoir des chiffres pairs, des chiffres ronds, des multiples de trois, des décimales. Des listes à puces, des cases à cocher. Partout, des grilles autour de moi, comme des grillages. Et le sentiment de ne pas avancer. Juste celui de tourner en rond comme un hamster.
Une grille en deux dimensions
Puis un jour, je suis tombé – plus ou moins par hasard – sur le blog d’un excellent vulgarisateur belge — Didier Goudeseune — qui m’a fait découvrir ce qu’était la taxonomie SOLO. Quatre niveaux de compréhension. Quatre niveaux de complexité croissante : l’élève peut identifier et nommer un élément, l’élève peut reconnaître quelques éléments, l’élève peut faire des liens entre les éléments qu’il reconnaît, l’élève peut déduire des idées nouvelles à partir des liens qu’il fait sur les choses qu’il reconnaît.
Ma grille est passée dans une deuxième dimension. La taxonomie SOLO m'a fourni l'échelle pour observer où en est l'élève dans son développement cognitif : idées isolées, sans liens véritables (préstructurel/unistructurel) ; idées multiples mais juxtaposées, non intégrées (multistructurel) ; idées reliées en un système cohérent (relationnel) ; généralisation et transfert à d'autres contextes (abstrait étendu).
Avec SOLO, je ne demandais plus « Est-ce que l'introduction est de qualité ? mais «À quel niveau de complexité cognitive l'élève organise-t-il sa pensée ?» Et je me suis rendu compte que ces niveaux étaient applicables non seulement dans mes cours de littérature, mais aussi dans mes cours de cinéma. Et dans combien d’autres cours encore. Ils décrivaient la structure des résultats d’apprentissage ! SOLO : Structure of Observed Learning Outcomes.
Quelque chose cloche
Jusqu’à ce que je m’interroge encore une fois. J’étais pas certain de tout ça, il manquait quelque chose. Surtout, j’étais en train d’avoir une idée folle…
À voir mes élèves entrer et sortir du cours, c’est comme si j’avais senti leur anxiété à essayer de me deviner. Et j’ai eu le goût de faire une différence. Je me suis assis à côté de mes élèves, j’ai pris leur crayon, j’ai écrit sur leur feuille. Je leur ai donné des réponses. J’ai expliqué pourquoi c’était des bonnes réponses. Et j’ai expliqué comment faire pour y arriver. Et j’ai redonné le crayon en faisant un clin d’œil. On va refaire le raisonnement ensemble, ok ? Après tu essaieras tout seul, puis on verra comment ça se passe.
Devant le destin, devant la fatalité des calculs. Je me suis mis à enseigner… de façon explicite. J’ai lâché la messe en latin !
De la profondeur
Puis un jour, des collègues chercheuses m'ont introduit à une approche pédagogique qui était très différente de ma pratique en littérature. Tellement, en réalité, que cette approche m'a complètement déchaussé et qu'elle a transformé ma façon d'enseigner. C'était ELLAC – l'enseignement de la lecture littéraire au collégial. Ici la grille d’évaluation n’appliquait pas le mode structurel que je connaissais trop bien, mais des critères organiques, moins mécaniques, complètement holistiques, qui exigeaient de moi non pas des qualités de comptable, mais de juge. J'ai accepté cette grille comme un pari, en faisant confiance à celles qui l'avaient créée, puis j'ai plongé. J'étais prêt pour autre chose. Après 25 ans d’enseignement.
ELLAC (ellac.ca) m'a appris à enseigner la lecture littéraire comme un processus de pensée complexe. Pas juste pour « comprendre l’histoire », mais développer des stratégies cognitives sophistiquées : repérer l'implicite, relier les éléments symboliques, adopter différentes postures de lecture, construire une interprétation plausible. On me proposait une grille de cinq critères interdépendants et je les ai adaptés à mon contexte : Structure, Rigueur, Plausibilité, Nuance, Français. Ce n’est pas une liste d'items à cocher, c'est une cartographie des dimensions qui composent la compétence en lecture littéraire. Voire en littératie tout court.
Rencontre du 3e type
Je croyais avoir expérimenté beaucoup de grilles d'évaluation et beaucoup de choses en général. Des grilles pour toutes sortes de cours, toute sorte de contextes, toute sorte d'objectifs. De la classe inversée à la classe collaborative ultra techno. Mais je ne m'étais jamais vraiment interrogé sur la construction de la note comme telle parce que, selon ma compréhension des choses, il suffisait de faire une simple opération mathématique.
C'était pas sorcier : la note se créait toute seule, alignée, pondérée, arrondie, automatisée dans mon tableur. Même pas besoin de calculatrice. D’année en année, de trimestre en trimestre, je ressortais les mêmes formules. SOMME(D6:D16) ou (D6+D10+D16)/60. Tout ça se réglait tout seul, sans même… réfléchir. Comme le destin. Quelques touches sur le clavier, puis «Enter», c'est parti mon kiki !
Tout est tellement automatique, que la note existe parfois avant même l'évaluation qui y conduit. Elle est là, fixée, conditionnée, déterminée, isolée. Et le tableur est insensible. Il applique indifféremment la logique du ratage et le processus de l’eurêka.
Non, ça cloche encore...
C'est comme ça, après trente ans à appliquer une pratique sommative traditionnelle et une pédagogie implicite, que je me suis mis à défier les tables de la Loi. À expérimenter une autre pratique. À appliquer, avec ces nouvelles connaissances, une autre logique, d'autres valeurs et une vision complètement différente de la justice et de l’équité.
La PAN – la pratique alternative de notation – est ma rencontre du troisième type. C’était la partie manquante de cette pédagogie renouvelée. Au lieu de figer l'élève dans un pourcentage à mi-parcours, je me suis mis à décrire son niveau actuel avec des codes non chiffrés (I-D-M-E) et je lui donnais le droit de se reprendre, d'évoluer, de progresser. Neuf artefacts dans le portfolio, quatre retenus pour l'évaluation finale. La note ne sera pas la moyenne arithmétique de toutes ses tentatives, mais la démonstration de ses acquis en fin de parcours.
Ensemble, avec l’enseignement explicite, ces trois éléments créent une cohérence que je n’avait même pas imaginée : ELLAC définit ce que j'enseigne (la lecture comme pensée complexe), SOLO définit comment j'observe le développement cognitif, et la PAN définit comment j'accompagne ce développement sans le sanctionner prématurément.
De tout cela, je n’ai rien inventé. Je l’ai appris. En faisant moi-même des erreurs. À force de me questionner, à force de lire. À force de me former et d’apprendre. À force de discuter avec des enseignant·es venus d’ailleurs : autant de créatures extra-terrestres issues d’autres disciplines que d’autres institutions. Je l’ai appris en observant mes élèves comme on observe... un potager se développer.
De la pensée réductrice à la pensée complexe
Tout récemment, une lecture d’Edgar Morin m'a aidé à comprendre ce que j'avais fait intuitivement. Ça vaut la peine qu’on s’y arrête un instant. Dans La nature de la nature (La Méthode tome 1), cet incroyable penseur distingue pensée réductrice et pensée complexe. La pensée réductrice simplifie, isole, fragmente. Elle «mutile». Dans l'évaluation traditionnelle, elle réduit un élève à une somme de performances isolées : introduction + développement + conclusion – les fautes = 68%. Elle isole chaque erreur. Elle fixe le développement dans un instant T.
La pensée complexe, elle, relie, contextualise, reconnaît les interactions. Elle voit l'élève comme un système en développement. Elle comprend que la structure influence la nuance, que la rigueur soutient la plausibilité, que le français est surtout une question de structure et d’articulation, pas d’application de règles. La pensée complexe reconnaît que l'apprentissage n'est pas prévisible et linéaire, mais qu’il est parfois surprenant, fait d'avancées et de reculs, de plateaux et de rebonds.
Enfin sortir de la roue, enfin sortir de la boîte. Avec un sentiment de cohérence tout à coup. De cohésion. En évaluant avec ELLAC-SOLO-PAN, j'incarne la pensée complexe parce que je la vis dans ma pratique. Et je crois que c'est exactement ce dont mes élèves auront besoin pour naviguer le monde de demain. L'intelligence artificielle, la crise climatique, les bouleversements sociaux : aucun de ces défis ne se résoudra avec une liste de cases à cocher. Ils exigent qu'on pense les relations, les interactions, les contextes. Qu'on tolère l'incertitude. Qu'on se trompe, qu'on accepte de réviser nos hypothèses et… qu’on recommence.
L'évaluation comme pratique d'émancipation
Le tableur automatisé ne raisonne pas. La note peut être une somme de capitaux : culturel, scolaire, économique, social. Et par la somme que je fais, sans jugement critique, je cautionne les inégalités du système dans lequel je vis.
Or je suis libre, si je le veux. Je peux exercer mon libre arbitre devant l’inéluctable. Je peux exercer un choix libre et responsable. Je peux non seulement juger de la valeur d'une habileté en fonction de critères observables, mais aussi contextualiser ce comportement. Surtout, je peux lui offrir un autre contexte que celui de la sanction immédiate et irréversible. Pour justement faire une différence.
Une grille d'évaluation est composée de deux axes, l'un vertical, l'autre horizontal. À l'intersection des deux, là où on met le X, se trouve le jugement professionnel.
De quoi est constitué le jugement professionnel? En partie de l'expérience de l'observation critique, bien sûr, mais cette expérience ne vaut pas grand-chose quand elle n'est jamais accompagnée de sa propre remise en question. Appliquer la grille des autres? Appliquer une notation traditionnelle? Pourquoi faire? Ça mène où, ça ?
Pour être équitable, j'offre le même contexte à tout le monde : je n’évalue pas un capital ou un quelconque talent, j'évalue seulement ce que j'ai enseigné, dans le cadre que j'ai offert à tous pour développer les habiletés et la compétence. Peu importe le capital de départ, peu importe le temps nécessaire. J'ai enseigné, j'ai guidé, j'ai accompagné chacun et chacune du mieux que j'ai pu, jusqu'à la fin. Et c’est rendu à cette fin, uniquement, que j'évalue les acquis et les résultats des apprentissages.
L'évaluation n'est jamais neutre. Elle renseigne autant qu'elle mesure. En évaluant avec une pensée complexe, j'enseigne par ma propre pratique que le savoir est multistructurel, relationnel, étendu. Que l'erreur est une étape normale du développement. Que l'apprentissage est un processus vivant. Complexe. Fascinant. Et qu’il en vaut le coup.
Et par l'exercice de cette liberté pédagogique, je rends possible une certaine forme d'émancipation. La mienne d'abord – car j'ai cessé d'être le scribe d'un système céleste. Celle de mes élèves ensuite – car ils peuvent se voir autrement que comme un pourcentage anticipé, comprendre leur propre développement et le prendre en main. Juste assez pour pour dévier.
Pour devenir des penseurs complexes. Autonomes. Et pour dialoguer. _◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 1 novembre 2025
Références
Bélec, C. et Doré, R. (2023). Une recherche collaborative pour renouveler l'enseignement de la littérature au collégial dans une optique de cohérence disciplinaire : l'intérêt d'une approche par compétence de la lecture. [Rapport de recherche PAREA]. Cégep Gérald-Godin et Cégep de Drummondville.
Biggs, John B. & Kevin F. Collis (1982), Evaluating the Quality of Learning ; The SOLO Taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome). Elsevier Inc.
Clark, R., & Talbert, R. (2023). Grading for Growth: A Guide to Alternative Grading Practices that Promote Authentic Learning and Student Engagement. Stylus Publishing.
Conseil supérieur de l'éducation. (2018). Évaluer pour que ça compte vraiment, Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018. Gouvernement du Québec.
Gauthier, C. & Bissonnette, S. (2023), Enseignement explicite et données probantes. Gaëtan Morin Éditeur.
Gauthier, C., Bissonnette, S., & Richard, M. (2013). Enseignement explicite et réussite des élèves : La gestion des apprentissages. Gaëtan Morin Éditeur.
Goudeseune, D. La taxonomie SOLO et l’alignement constructif, dans Par temps clair [En ligne]
Hattie, J. & G. C. R. Yates (2020), L'apprentissage visible - ce que la science sait sur l'apprentissage. ERPI.
Hollingsworth, J., & Ybarra, S. (2012). L'enseignement explicite. Chenelière.
Morin, E. (1977-2006, nouv. éd. 2008). La méthode (tome 1): La Nature de la nature. Seuil.
Nilson, L. B. (2014). Specifications Grading: Restoring Rigor, Motivating Students, and Saving Faculty Time. Stylus Publishing. (page 128)
Pasquini, R. (2021). Quand la note devient constructive : Évaluer pour certifier et soutenir les apprentissages. Presses de l’Université Laval.
B. Voisard, C. Cormier & F. Arseneault-Hubert (2024), Les pratiques alternatives de notation. Pour mieux soutenir les apprentissages et en témoigner, Pédagogie collégiale, vol. 37, n˚2, p. 27 [En ligne]
À explorer
Pour découvrir les fondements de cette transformation pédagogique :
- 11‣ Enseigner la lecture littéraire au collégial - L'approche ELLAC qui a marqué la rupture avec les grilles techniques traditionnelles, introduisant des critères holistiques (Structure, Rigueur, Plausibilité, Nuance) et quatre postures de lecture pour développer la littératie comme pensée complexe.
- 7‣ Dépister avec la taxonomie SOLO - La découverte de l'outil qui a fait passer la grille d'une dimension à deux dimensions, permettant d'observer les niveaux de complexité cognitive (IDME) plutôt que de simplement compter des points sur une liste d'items.
- 5‣ Mettre en place une pratique alternative de notation (PAN) - La «rencontre du troisième type» qui complète la cohérence du système ELLAC-SOLO-PAN : comment remplacer la moyenne arithmétique par l'évaluation des acquis en fin de parcours, avec jetons de reprise et portfolio d'apprentissage.
- 29‣ Évaluer la qualité de l'apprentissage - L'approfondissement théorique qui révèle comment SOLO structure l'alignement constructif et permet de passer d'une évaluation centrée sur le «combien» à une appréciation du «comment», favorisant une mentalité de développement plutôt que de performance.
- 46‣ Cultiver la pensée complexe face à l'IA - Le cadre conceptuel d'Edgar Morin qui éclaire toute cette transformation : comprendre la distinction entre pensée réductrice (qui simplifie, isole, fragmente, «mutile») et pensée complexe (qui relie, contextualise, reconnaît les interactions systémiques) pour saisir pourquoi changer de grille n'est pas qu'une question technique, mais un changement de paradigme.