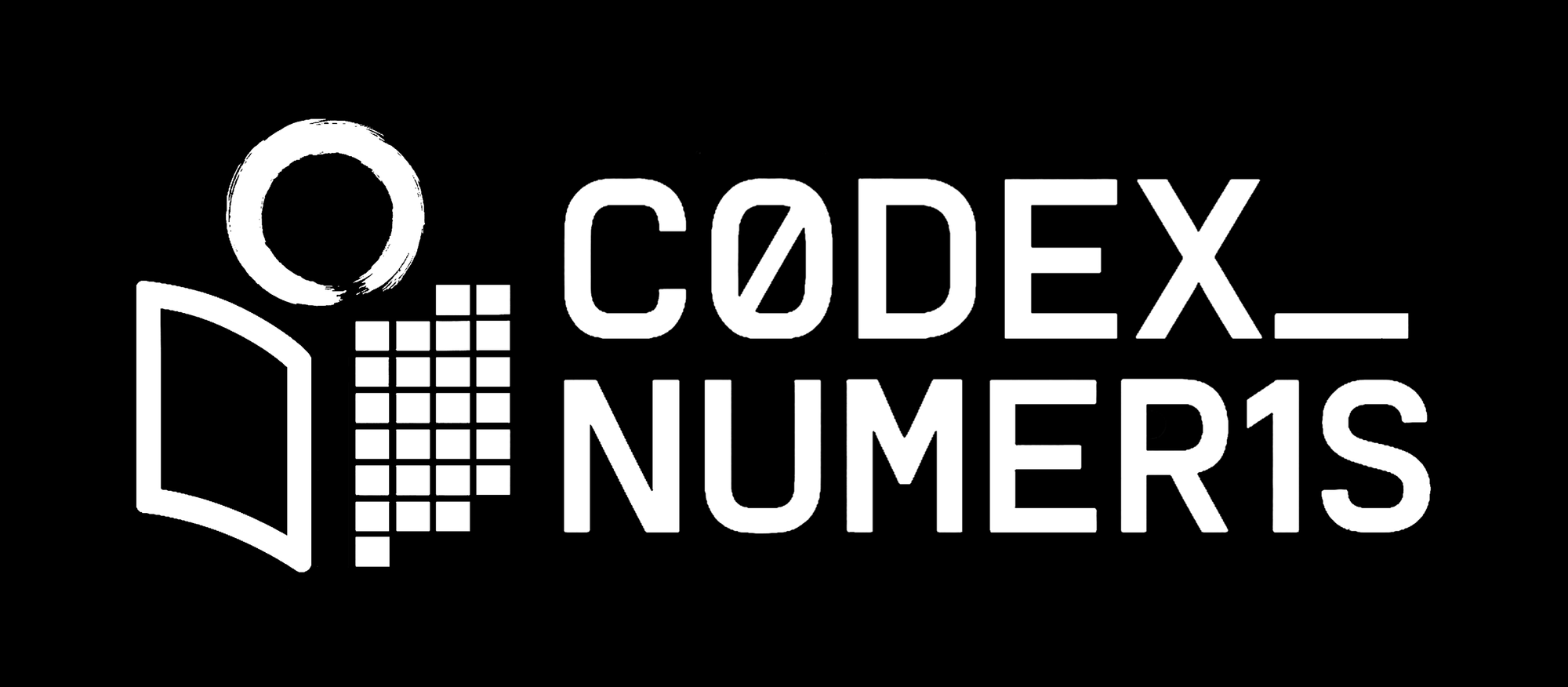49‣ L’alignement pédagogique
Pourquoi certains de mes cours fonctionnent et d’autres pas. Des années. Avant de comprendre qu'il s'agissait d'alignement pédagogique.

J’ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi certains de mes cours fonctionnaient et d’autres pas. Beaucoup de temps à choisir des œuvres que j’aimais, à créer un calendrier d'activités qui me semblaient intéressantes, à tricoter et détricoter des grilles d’évaluation de trimestre en trimestre. Des années, avant de comprendre qu'il s'agissait d’alignement pédagogique.

► QUAND j’ai commencé à enseigner, personne ne m’a expliqué ce concept. On m’avait donné le plan de cours de mes collègues, le devis ministériel, quelques manuels de référence et, essentiellement : « Bonne chance ». J’ai donc fait comme mes propres profs avaient fait avec moi. Je sélectionnais des textes, je préparais des explications, je donnais des travaux, je comptais des points. Parfois ça marchait. Souvent, pas trop.
Ce n’est que bien plus tard, des années plus tard, lors d’une formation sur l’enseignement efficace, que j’ai compris ce qui clochait : mes cours n’étaient pas alignés. Les activités ne menaient pas nécessairement quelque part. Les œuvres choisies ne convergeaient pas vers un même objectif. Les évaluations ne mesuraient pas toujours ce que j’avais enseigné. Pire : je n'avais pas toujours enseigné ce que j'évaluais. J’avais construit des cours en archipel plutôt qu’en trajectoire.
J’aurais aimé qu’on me l’explique dès le début. Mais bon, je n'avais aucune formation, aucune expérience. J'ai fait de mon mieux.
Faire l’alignement pédagogique d’un cours (qu'on appelle aussi l'alignement constructif ou curriculaire), c’est définir le point de départ et le point d’arrivée de la trajectoire d’apprentissage de manière à organiser les points intermédiaires de la façon la plus efficiente possible. Chaque étape dans ce parcours sert à consolider les acquis et les orienter vers leur développement afin d’atteindre un objectif précis.
Dans le concret des choses, cela peut se traduire par décrire quelles sont les habiletés ou les compétences que l’on souhaite avoir en fin de parcours et, à rebours, identifier et planifier la construction des acquis nécessaires à leur atteinte. Je veux par exemple que mes élèves développent une compétence en lecture et en écriture — disons la capacité d’interpréter et d’exprimer des idées complexes. Je dois d’abord définir cette compétence et décrire quels éléments observables sont requis pour en apprécier l’atteinte.
Pour interpréter et exprimer des idées complexes, je juge par exemple qu’il est nécessaire d’avoir un certain niveau de structure, de rigueur, de plausibilité et de nuance dans la pensée (ce sont les critères de l’approche ELLAC dans l’enseignement de l’analyse littéraire). Ce niveau s’observe quand l’élève est non seulement capable d’identifier des éléments, mais également capable de les mettre en relation afin d’en saisir le sens (ce sont les niveaux multistructurel et relationnel de la taxonomie SOLO). Concrètement, l’auteur ou l'autrice exprime un message implicite dans un chapitre ou une nouvelle, et je veux que mon élève puisse nommer et articuler les éléments de ce discours. Je veux que mon élève puisse apprécier le fonctionnement du langage littéraire qui est au service d’un objectif de communication.
Je vais donc construire des activités d’apprentissage qui permettront à l’élève d’acquérir des connaissances en lien avec l’objectif. Je planifierai par exemple la lecture d’un chapitre préparatoire qui permettra de reconnaître les propos du texte, de repérer et classer des thèmes et des procédés langagiers, et d’opérer certaines actions selon une certaine procédure (ce sont les éléments de compétences du cours Écriture et littérature présentés dans le devis ministériel, par exemple).
Ces activités nécessitent des savoirs dont je vais planifier l’acquisition dans d’autres activités préalables. Et ainsi de suite. Je vais organiser à rebours le parcours d’apprentissage de mes élèves, de la fin jusqu’au début du trimestre.
Aujourd’hui, l’alignement pédagogique est une stratégie dont je ne me passerais pas. Quand tout est bien aligné, le choix des œuvres est cohérent avec l’objectif final et elles offrent une progression vers la complexité. De la détermination des critères et de leur niveau de maîtrise jusqu’à la rétroaction qui en découle, des différentes stratégies appliquées dans les exercices aux habiletés cognitives qu'elles sollicitent, tout concourt à consolider la compétence, tout converge vers un point focal clair et précis. L’alignement pédagogique n’est rien d’autre que la cohérence et la cohésion d’un cours.
C’est la même chose qui se produit ici que dans l’écriture d’un scénario de film : si l’ordre des scènes peut être changé sans que cela modifie quoi que ce soit dans ma compréhension, c’est que leur progression n’est pas assez élaborée, leur causalité n’est pas assez rigoureuse. Elles manquent de motivation. Si je peux retirer une scène du scénario sans que cela ne nuise à la compréhension globale, c’est que la scène n’a aucune nécessité. De la même façon, si un exercice pédagogique n’est pas nécessaire à l’atteinte de la compétence ou d’une habileté particulière, c’est qu’il fait diversion et qu’on pourrait très bien s’en passer.
Constater qu'un cours est construit de façon réfléchie peut être très rassurant pour un·e apprenant·e, mais aussi pour un·e enseignant·e. La cohésion donne du sens et participe à l'efficacité. Mais ça m’a pris du temps pour y arriver. Peut-être un peu trop.
Il n’est pas toujours facile de faire ce choix de l'alignement, parce que parfois nous avons un coup de cœur pour une œuvre, ou nous sommes attachés à certaines activités dans lesquelles nous avons investi du temps et de l’énergie, ou nous pratiquons d’une certaine manière parce que c’est ainsi que nous l’avons appris. Mais l’alignement pédagogique, comme au cinéma, c’est l’art de ne rien laisser au hasard.
Je comprends aujourd'hui que cet alignement m'a demandé du temps, de l’expérimentation continue, des essais et des erreurs qui font de moi un apprenant. Mais j’aurais aimé commencer plus tôt et ça aurait été bien qu'on s'en parle entre nous. _◀︎
Modalités éditoriales
H
CC BY-SA 4.0 (Attribution - Partage dans les mêmes conditions)
Publié le 3 octobre 2025
Références
Gauthier, C. & Bissonnette, S. (2023), Enseignement explicite et données probantes. Gaëtan Morin Éditeur.
Gauthier, C., Bissonnette, S., & Richard, M. (2013). Enseignement explicite et réussite des élèves : La gestion des apprentissages. Gaëtan Morin Éditeur.
Hollingsworth, J., & Ybarra, S. (2012). L'enseignement explicite. Chenelière.
À explorer
Pour comprendre le cadre théorique de l'alignement :
- 29‣ Évaluer la qualité de l'apprentissage - Comment la taxonomie SOLO opérationnalise concrètement l'alignement constructif en permettant de spécifier précisément les niveaux de complexité structurelle visés, d'analyser systématiquement les tâches d'évaluation et d'adapter la progression du simple au complexe dans la zone proximale de développement des élèves.
Pour découvrir l'application pratique de l'alignement :
- 27‣ Pratiquer l'enseignement explicite - Comment l'alignement pédagogique se traduit concrètement dans une progression structurée (modelage → pratique guidée → autonomie) où chaque phase consolide les acquis nécessaires pour atteindre les objectifs visés, illustrant la cohérence entre enseignement, pratique et évaluation.
Pour voir l'alignement des critères d'évaluation :
- 2‣ Enclencher une boucle de rétroaction - Comment l'application de critères constants à tous les travaux – tant formatifs que sommatifs –crée une cohérence longitudinale qui permet aux élèves de comprendre progressivement les standards d'apprentissage et de visualiser clairement leur trajectoire de progression.
Pour approfondir la dimension réflexive :
- 4‣ Centrer l'apprentissage sur le processus - Comment l'alignement pédagogique transforme également la posture de l'enseignant en apprenant, révélant que la construction d'un cours cohérent exige une expérimentation continue, des ajustements constants et une réflexion métacognitive sur sa propre pratique.